Sommaire
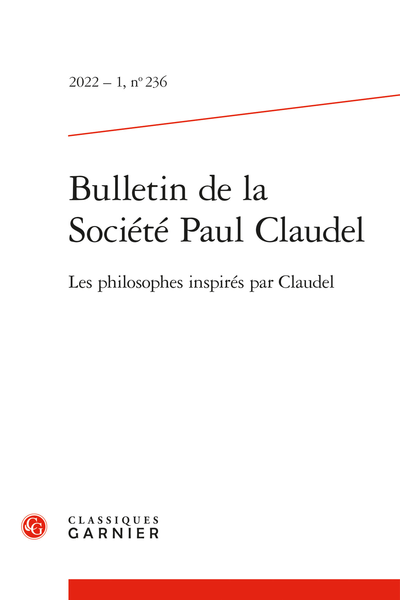
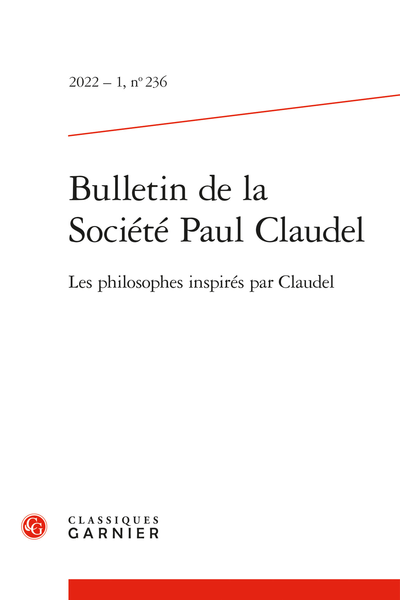
LES PHILOSOPHES INSPIRÉS PAR CLAUDEL /
PHILOSOPHERS INSPIRED BY CLAUDEL
Catherine Mayaux et Marie-Victoire Nantet
Avant-propos / Foreword, 13
Éric Touya de Marenne
Habiter poétiquement le monde. Claudel et Marion /
Poetically inhabiting the world. Claudel and Marion, 15
Stephen E. Lewis
L’Incarnation selon Claudel comme inspiration philosophique chez Merleau-Ponty /
The Incarnation from Claudel’s perspective as philosophical inspiration for Merleau-Ponty, 27
Graciane Laussucq Dhiriart
Claudel et les philosophes chrétiens /
Claudel and Christian philosophers, 37
Didier Alexandre
Claudel le tragique selon Lacan /
Lacan’s tragic Claudel, 45
INÉDIT / PREVIOUSLY UNPUBLISHED
Claude Pérez
Deux lettres inconnues de Claudel à Jean Royère à propos de L’Oiseau noir dans le soleil levant /
Two unknown letters from Claudel to Jean Royère about L’Oiseau noir dans le soleil levant, 63
NOTE / NOTE
Jean-François Poisson-Gueffier
Paul Claudel et la mort de Palinure. Virgile, Énéide, V, 835-861 /
Paul Claudel and the death of Palinurus. Virgil, Aeneid, V, 835–861, 69
RELECTURE / REREADING
Stanislas Fumet, Histoire de Dieu dans ma vie
(S. Barbora Turkova), 79
HOMMAGE / TRIBUTE
Anne Mantero
Marc Fumaroli, 85
POINTS DE THÈSE / THESES
Paul Claudel et ses livres. Réalisation et étude du catalogue de la bibliothèque du château de Brangues /
Paul Claudel and his books. Creating and studying the catalog from the library at the Château de Brangues
(Agnese Bezzera), 91
La représentation de Dieu dans le drame de Paul Claudel /
The representation of God in the dramas of Paul Claudel
(Armelle de Rincquesen-Corman), 93
Rédemption et délivrance. Présence du bouddhisme dans le théâtre de Paul Claudel /
Redemption and deliverance. The presence of Buddhism in the theater of Paul Claudel
(Huang Guanqiao, Jiang Yinuo), 94
EN MARGE DES LIVRES / IN THE MARGINS
Claude Pérez, Paul Claudel. « Je suis le contradictoire »
(Jacques Parsi), 99
Paul Claudel et Saint-John Perse, chemins croisés, sous la direction de Muriel Calvet et Catherine Mayaux
(Yves Fravalo), 101
ACTUALITÉS / NEWS
Henriette Levillain
« Pour fêter la Poésie ». Jeudi 18-Samedi 20 novembre 2021 /
“To celebrate Poetry”. Thursday 18–Saturday 20 November 2021, 109
Résumés /Abstracts, 113
CLAUDEL LE TRAGIQUE SELON LACAN
Le cycle des Coûfontaine de Claudel occupe, auprès de l’Antigone de Sophocle et de l’Hamlet de Shakespeare, une place majeure dans l’histoire de la tragédie européenne que construit Jacques Lacan. Le théâtre de Claudel intéresse Lacan, et non la personne, la vie, la psyché de Paul Claudel. Et quand il explore les drames, en « serr[ant] de près les textes » et en suivant sa « méthode implacable de commentaire des signifiants », il n’a pas pour but d’en faire les illustrations exemplaires d’une théorie dont les « termes », le « symbolique », le « signifiant », le « désir», pourraient un jour « servir à quiconque de gri-gri intellectuel ». Pourquoi Claudel, et en particulier ces trois drames, sont-ils nécessaires à la réflexion que Lacan et son auditoire mènent sur leur pratique d’analystes et sur la relation qu’ils établissent avec leur patient ? « Qu’allons-nous faire du côté de Claudel ? » Il suffit de replacer dans la chronologie du séminaire les trois auteurs tragiques pour vérifier la pertinence de cette question : dans Le Désir et son interprétation, Lacan introduit l’Hamlet de Shakespeare; dans L’Éthique de la psychanalyse, il introduit, après Kant et Sade, l’Antigone de Sophocle; dans Le transfert, après le Banquet de Platon qui étudie, chacun le sait, l’amour, il commente L’Otage, Le Pain dur, Le Père humilié, ce qu’il appelle la « mythologie claudélienne ». Ces séances du séminaire forment un ensemble qui formule une théorie complète, et fort complexe, du tragique et de la tragédie, en dialogue constant avec la Poétique d’Aristote. L’amplitude théorique – psychanalytique et littéraire – et chronologique, du monde grec au monde contemporain de Freud et Claudel, et de Lacan, sont ainsi l’envers d’une enquête menée sur la pratique de l’analyste. Il n’en est pas moins surprenant de trouver Claudel au terme de cette enquête, que son catholicisme ne désignerait guère comme un auteur qui s’avère nécessaire à la psychanalyse et à une réflexion sur le désir, l’amour, la mort et le transfert.
Lacan ne fait pas œuvre de critique littéraire au sens académique du terme. Les jugements rapides de Claudel sur Freud ne le retiennent jamais. Et il ne souhaite pas donner une lecture psychanalytique de l’œuvre de Claudel comme le fait, par exemple, Charles Mauron de la comédie classique. De même, il n’est guère préoccupé d’interpréter les rêves ou les phantasmes ou la place des relations père, mère et fils dans l’érotique claudélien – autant de lectures qui ont été faites par la critique claudélienne, non sans susciter des réticences1. Il aborde le texte claudélien parce qu’il contribue à la compréhension de la place que l’analyste occupe dans la cure et de la demande que fait l’analysé à l’analyste durant cette cure. Il revient régulièrement sur ces questions. Ainsi, après sa lecture des trois drames de Claudel, il insiste :
« Comment situer ce que doit être la place de l’analyste dans le transfert ? – au double sens où je vous ai dit la dernière fois qu’il faut situer cette place – où l’analysé situe-t-il l’analyste ? – où l’analyste doit-il être pour lui convenablement répondre ? » Cette place, il n’est pas facile de la configurer. L’analyste est face au texte du patient et de Claudel en position de lecteur et d’auditeur qui écoute et voit. S’il possède un solide savoir que lui donnent la théorie et sa pratique, cela seul ne lui dicte pas face au drame – du patient ou de Claudel – « une conduite à tenir ». Le savoir objectif de l’inconscient est nécessaire, mais non suffisant. Car l’« être » de l’analyste est aussi intéressé dans le lien qui s’établit entre lui et son patient. L’être, c’est-à-dire pour Lacan, le désir, la passion.
« Quelque chose qui ressemble à l’amour, c’est ainsi que l’on peut, en première approximation, définir le transfert. » Et c’est bien parce qu’il est affecté par le cycle de Claudel que Lacan s’intéresse à lui. À plusieurs reprises, il qualifie ces drames de scandales. Par exemple, dans Le Père humilié et Le Pain dur, « dans la tragédie claudélienne », il dit retrouver, on ne peut que s’y attendre, la figure du père, objet de « la plus extrême dérision, d’une dérision qui confine même à l’abject. » Et il conclut :
« N’est-ce pas étrange que l’on n’ait pas crié davantage au scandale devant cette pièce ? » De même, il qualifie le dénouement de L’Otage d’« énormité» : « Une chose pareille a pu venir au jour de l’imagination humaine. » Là se précisent à la fois la place et le discours que peut tenir l’analyste lecteur de Claudel et du patient. L’énormité, « les étrangetés», « les invraisemblances et les traits de scandale » dépassent les limites de ce qui peut être lu, vu et entendu au théâtre : Claudel est hors limites, en excès par rapport à la poétique aristotélicienne de la purgation des passions à travers la crainte, ou la terreur et la pitié. Ce ne sont pas les « conflits sentimentaux du XIXe siècle » – tels les relents wagnériens que certains retrouvent dans Partage de midi – qui nous touchent et nous retiennent. « Il y a quelque chose d’autre dans cette image, où les termes nous manquent. » Et nous verrons qu’ils manquent aussi à Claudel. Le lecteur analyste a la charge de mettre sur cet « autre chose » des mots à partir du texte même de Claudel, alors même qu’« ici, nous sommes au-delà de tout sens. » Cet excès innommable, c’est l’objet de l’analyse et c’est cela qui intéresse, passionne même, Lacan en Claudel.
Cette notion d’image ne doit rien au hasard. La tragédie de Claudel, comme toute tragédie, n’est pas pour Lacan un spectacle. La relation, dans le transfert et dans la lecture critique, relève du narcissisme, du rapport à « l’image, telle [qu’il] l’[a] déjà articulée […] dans la fonction du narcissisme, comme ce qui représente, dans un certain rapport, le rapport de l’homme à sa seconde mort, le signifiant de son désir, son désir visible. » Au centre de la tragédie, il y a l’image d’Antigone, ou de Sygne, ou de Lumîr, ou de Pensée qui nous fascine. « C’est du côté de cet attrait que nous devons chercher le vrai sens, le vrai mystère, la vraie portée, de la tragédie. » La tragédie relève ainsi de l’imaginaire lacanien et donc du stade du miroir où il faut mettre des mots sur la forme visible et perçue, où le désir trouve à être signifié2. Ce dialogue en miroir, le psychanalyste le retrouve au cœur même de la tragédie claudélienne. Dans l’analyse, selon Lacan, se joue une partie complexe de bridge, l’analyste ayant « en face de lui son propre petit autre, ce en quoi il est avec lui-même dans ce rapport spéculaire en tant qu’il est constitué comme moi. » Quant à l’analysé, qui joue avec un mort, « il doit trouver la vérité de cet autre, qui est le grand Autre de l’analyste. » Dans la lecture critique, le critique analyste doit donc trouver dans les personnages son moi propre. Quant à ces personnages, ils sont engagés dans une partie de cartes complexe – l’image de la relation qui s’établit entre analyste et analysé, lecteur et texte : c’est cette partie que retrouve Lacan dans la partie de whist évoquée à l’ouverture du Pain dur, où « le père [est] bafoué, joué», ce qui est un thème classique de la comédie :
« il faut entendre joué dans un sens qui va plus loin que le leurre et la dérision – il est joué, si l’on peut dire, aux dés. » Turelure, pour Lumîr et Sichel, se retrouve dans la position du mort : il est le mort de leur désir. Lacan résume ainsi la scène : « Jouez votre jeu, je joue le mien, j’ai mes atouts aussi, toutes deux contre le mort3. »
Cette métaphore du jeu nous renvoie à la pensée structuraliste, celle de Lévi-Strauss, et à la critique que peut en faire Derrida. Comme la méthode freudienne, la méthode de Lacan face au « déterminisme des symptômes » repose sur le mythe : la démarche s’apparente cependant à celle qui est formulée dans le chapitre xi, La structure des mythes, de l’Anthropologie structurale. Lacan donne une lecture très œdipienne du Pain dur qu’il déplace dans un second temps sur L’Otage. « Que ce qui se passe dans Le Pain dur, c’est le mythe d’Œdipe, je crois que vous n’en doutez plus maintenant. » Et il conclut : « C’est précisément ce qui se passe au départ, à l’étage au-dessus, et illustré alors d’une bien autre manière, et faite cette fois pour réveiller notre sensibilité endormie ? Je veux dire – n’est-ce pas ça qui se passe au niveau de Sygne ? » Or, que se passe-t-il dans les drames de Claudel, dans la succession de trois générations, pour Sygne, Louis de Coûfontaine et enfin Pensée ? « On retire au sujet son désir, et, en échange, on l’envoie sur le marché, où il passe dans l’encan général. » Lacan ne recherche pas une application littérale du mythe d’Œdipe – la transposition de la fable des labdacides dans les fables claudéliennes. Le mythe est conçu comme une structure fondamentale qui est remise en jeu par chacun, patient ou dramaturge, comme un langage dans lequel sont pris le sujet et son histoire. Le Pain dur présente en fait une « exemplaire décomposition structurale du mythe », pour plusieurs raisons au moins, puisque Louis ne tue pas Turelure, qui meurt de peur, puisqu’il sait qu’il épouse la femme de son père, Sichel, à la différence d’Œdipe qui l’ignore, puisqu’enfin il y est poussé par Lumîr, son amante, qui est animée du désir de mort. De même, dans L’Otage, Turelure tue Georges de Coûfontaine, figure de l’ancêtre et du père, pour posséder sa sœur de lait, Sygne, figure de la mère. Néanmoins, c’est la même Sygne qui se jette devant Turelure pour le protéger contre la balle tirée par Georges, en un geste énigmatique qui obéit à des motivations incertaines et au désir de mort. Les trois personnages, Georges, Turelure, Sygne, baignent dans l’inceste en le sachant, à la différence d’Œdipe et de Jocaste. Enfin, dans L’Otage et Le Père humilié, se retrouve une autre « fonction » du mythe que le rapport père-fils ou l’inceste : il s’agit des « frères ennemis » – Étéocle et Polynice –, Georges et Turelure, Orian et Orso, rivaux non pour le pouvoir, mais pour l’amour et la jouissance de Sygne et de Pensée, tous deux voués à la destruction et à la mort par Sygne et Pensée et par le désir de Pensée indissociable de la mort de ses amants4. « C’est à notre désir, et comme la révélation de sa structure, qu’est proposé ce fantasme [la fusion des âmes dans la dernière scène du Père humilié], qui nous révèle quelle est la puissance magnétique qui nous attire dans la femme, et pas forcément, comme dit le poète, en haut – que cette puissance est tierce, et qu’elle ne saurait être la nôtre qu’à représenter notre perte. Il y a toujours dans le désir quelque délice de mort, mais d’une mort que nous ne pouvons nous-même nous infliger5. » À ce premier mythe s’en noue un second, formulé par Freud dans Totem et tabou auquel Lacan se réfère maintes fois quand il traite de l’éthique de la psychanalyse, celui du meurtre du père par la horde primitive qui a pour effet la consolidation du règne de la loi et de l’interdit qui régule la circulation des biens au prix du refoulement du désir, ce que l’on retrouve aisément dans le dénouement de chacun des trois drames du cycle des Coûfontaine, et qui est présent dès les premiers drames, Tête d’Or et La Ville.
Ce que met donc en évidence Lacan, à travers ces répétitions générationnelles de la structure, c’est l’importance du savoir et du désir de mort – qui, si l’on veut bien y réfléchir, traversent d’autres drames, Partage de midi, L’Annonce faite à Marie, Le Soulier de satin, où néanmoins l’inscription de l’inceste est moins explicite. Claudel ne répète pas la structure : il la transforme de drame en drame pour en donner des versions modernes, la version du XXe siècle. Le drame claudélien, appelons-le ainsi pour le moment, dépasse donc la tragédie antique de deux manières, par une « décomposition structurale » qui fait basculer le tragique antique dans le comique si sombre du Pain dur, et par le franchissement des limites du tragique tel qu’il est fixé chez Sophocle dans le personnage d’Antigone. Dans le séminaire consacré à l’éthique de la psychanalyse, en se fondant sur les paradoxes de la libido, de l’amour et du désir, qui ne saurait être satisfait sans disparaître, ce qui noue inextricablement pour le sujet désir et mort, Lacan élabore une topologie du tragique. Il distingue, en particulier, la mort physique, naturelle, qui est destruction et décomposition selon les lois naturelles, de la seconde mort qui « situe le héros dans une zone d’empiétement de la mort sur la vie […] et suspend tout ce qui a rapport à la transformation, au cycle des générations et des corruptions, à l’histoire même ». Après son père Œdipe, Antigone, évidemment, occupe et assume cette place à laquelle la destine l’Atè, traduisons rapidement le malheur, des générations de sa famille. C’est de ce lieu hors de la vie, dans la mort, le tombeau où elle est condamnée à entrer vivante, qu’elle agit et parle. Cette seconde mort est voulue par le récit et par la loi. Elle peut être aussi appelée à s’éterniser dans la représentation, l’image du sujet souffrant, ou dans la parole. Antigone se dépeint en Niobé pétrifée et statufiée. C’est dire que cette seconde mort a à voir non pas avec la réalité mais avec le signifiant. La seconde mort « nous porte à un niveau plus radical que tout, en tant que comme tel il est suspendu au langage. » Pour Lacan, elle nous renvoie au désir fondamental de l’être, son désir de s’anéantir, qui doit être pris en charge par le symbolique et demeure donc, pour cette raison toujours inaccompli.
Antigone s’arrête à la limite de cette zone selon le psychanalyste.
« Elle reste dans les limites de sa destinée6. » L’héroïne grecque ne renie ni son destin ni son acte ni ce qui fait son être. Son acte et son sacrifice sont beaux et le demeurent dans la mémoire des hommes. Quant au spectateur – et au critique analyste –, il est illuminé par cette mort, il perd tout repère et franchit toutes les limites. « Le côté touchant de la beauté [d’Antigone] fait vaciller tout jugement critique, arrête l’analyse, et plonge les différentes formes en jeu dans une certaine confusion, ou plutôt un aveuglement essentiel. » L’esthétique et le jugement esthétique – on aura reconnu derrière ces lignes une référence implicite à la théorie kantienne du sublime qui suspend le jugement catégoriel – interdisent de voir la mort, c’est-à-dire le rien, le néant, la Chose, « cet inanimé où Freud nous apprend à reconnaître la forme dans laquelle se manifeste l’instinct de mort. » Ainsi le beau rend supportable le tragique, en refusant la vue de l’horrible, de l’abject, du déchet. S’il y a bien souffrance, il y a aussi terreur et pitié en ce que la beauté instaure une limite infranchissable7. La tragédie antique demeure donc en-deçà de la Chose. Cette lecture lacanienne tourne le dos à celle que fait Hegel de la tragédie d’Antigone dans la Phénoménologie de l’esprit dont Alexandre Kojève a donné du conflit entre Créon et Antigone une lecture importante à l’EHESS de 1933 à 1939, très répandue dans les milieux littéraires et intellectuels français. « Il ne s’agit pas d’un droit qui s’oppose à un droit, mais d’un tort qui s’oppose – à quoi ? À autre chose qui est ce que représente Antigone. » La tragédie a pour objet non pas le passage d’un droit sacré familial au droit de la cité, mais l’être d’un sujet pris dans un destin que lui imposent les générations. Et cet être est être de désir qui ne trouve son plein accomplissement, à travers l’amour, la violence, la jouissance, que dans la mort.
Il fallait ce détour pour mieux comprendre la raison pour laquelle Claudel est à Lacan ce que Sophocle est à Freud ou ce que Shakespeare est à Jones. Dans l’Éthique de la psychanalyse, Lacan fait explicitement référence à Claudel en qui il trouve la confirmation de ses réflexions sur le beau. Après avoir affirmé que chez les Hollandais, « n’importe quel objet peut être le signifiant par quoi vient vibrer ce reflet, ce mirage, cet éclat plus ou moins insoutenable, qui s’appelle le beau », il en appelle à Claudel et à l’Introduction à la peinture hollandaise pour mettre l’accent sur l’envers de cette beauté : « la nature morte nous montre à la fois et nous cache ce qui est en elle menace, dénouement, déroulement, décomposition, [et] présentifie pour nous le beau comme fonction d’un rapport temporel. » J’ai à maintes reprises rappelé que cette méditation claudélienne sur la fragile et précaire nature morte hollandaise, en équilibre dans l’instant et sur le point de s’effondrer et de passer, a son origine dans la théorisation de la forme qu’il donne dans le Traité de la co-naissance au monde et de soi-même : de la conception et de l’imagination, et donc aussi de l’image, il donne cette définition : « un arrangement démoli qui se refait8 ». Ce n’est pas par la question des genres littéraires que Claudel aborde le drame : c’est par celle de la forme, dont la photographie sera un des exemples les plus démonstratifs, et par celle de sa fonction d’illumination et de dissimulation du mouvement qui emporte les étants et la matière. Et qui les emporte vers quoi ? C’est dans le séminaire Le transfert que Lacan apporte une réponse à cette question qui demeure ouverte. Chacun des deux premiers traités de l’Art poétique de Claudel s’achève sur la mort et la béatitude promise à l’être. La vision et l’écoute mystique, et la beauté esthétique d’une vie dans la mort, rémunèrent la mort biologique, en quelque sorte. Cette sublimation par la poésie et le signifiant, qui prend la forme spirituelle d’une contemplation en miroir de l’Être et de soi et d’une « conciliation [sociale9] facile entre l’individu et le collectif » ne peut faire oublier ni le néant ni le désir indissociable de la mort. Ces clausules de chaque traité, lues littéralement, sont explicites sur ces points et abonderaient la thèse de Lacan :
Le temps est le moyen offert à tout ce qui sera d’être afin de n’être plus. Il est l’Invitation à mourir, à toute phrase de se décomposer dans l’accord explicatif et total, de consommer la parole d’adoration à l’oreille de Sigè l’Abîme10.
Notre occupation pour l’éternité sera l’accomplissement de notre part dans la perpétration de l’Office, le maintien de notre équilibre toujours nouveau dans un immense tact amoureux de tous nos frères, l’élévation de notre voix dans l’inénarrable gémissement de l’Amour11 !
Insistons. Lacan voit dans ce sublime du signifiant la sublimation, « créative d’un certain nombre de formes, dont l’art n’est pas la seule », créative de « l’art littéraire, si proche pour nous du domaine éthique ». Mais alors que l’esthétique semble maintenir dans l’Art poétique cette sublimation, au travers de références explicites à Baudelaire et au symbolisme contemporain, dans le cycle des Coûfontaine, Claudel outrepasse ce tragique sublime pour pénétrer un espace qui est au-delà du tragique sophocléen tel qu’Antigone, puis Œdipe à Colone, l’établissent. Ce tragique moderne, que met en place Claudel, réside dans la négation même de son destin par le personnage de Sygne. Claudel signe dans L’Otage un tragique du refus, choisi et assumé, de la promesse faite, de la parole donnée, de la loi, qu’elle soit ancienne ou nouvelle, qu’elle appartienne à l’Ancien Régime ou qu’elle soit issue de la Révolution française, de l’héritage et du destin, de l’être même.
Là où l’héroïne antique est identique à son destin, Atè, à cette loi pour elle divine qui la porte dans l’épreuve, – c’est contre sa volonté, contre tout ce qui la détermine, non pas dans sa vie, mais dans son être, que, par un acte de liberté, l’autre héroïne va contre tout ce qui tient à son être jusqu’en ses plus intimes racines.
Sygne incarne la négation, – la versagung de Freud12. Ce n’est pas le lieu, dans cette rapide étude, d’entrer dans les débats que soulève ce concept et qui exigent d’autres compétences. Qu’il soit suffisant de voir quelle convergence existe entre la conceptualisation de Lacan et la situation « existentielle » que crée Paul Claudel avec le personnage de Sygne. La versagung n’est pas une frustration : elle est « l’émergence comme telle du signifiant en tant qu’il permet au sujet de se refuser ». C’est dans le séminaire de La relation d’objet que la notion apparaît une première fois chez Lacan, qui la commente ainsi : « [Freud] parle de la Versagung, qui s’inscrit beaucoup plus adéquatement dans la notion de dénonciation, au sens où on dit dénoncer un traité, où on parle du retrait d’un engagement. Cela est si vrai que l’on peut même à l’occasion mettre la Versagung sur le versant opposé car le mot peut vouloir dire à la fois promesse et rupture de la promesse. C’est très souvent le cas dans ces mots précédés de ver –, préfixe si essentiel en allemand, et qui tient dans le choix des mots de la théorie analytique une place éminente. » Sygne fait une promesse qu’elle ne tient pas – à Georges de Coûfontaine, au curé Badilon, à Turelure lui-même. Elle fait cette promesse sachant qu’elle ne peut ni ne veut la tenir. « Tout ce qui est condition devient perdition. » Alors que le héros antique s’inscrit dans la dette contractée par les générations antérieures, le héros moderne de Claudel le refuse pour assumer un « destin [qui littéralement] ne soit plus rien ». On objecterait volontiers à Lacan que le sacrifice de Sygne se réalise selon le modèle du sacrifice rédempteur du Christ, lorsque le curé Badilon la convainc d’accepter le mariage avec Turelure dans la scène 2 de l’acte II de L’Otage. Lacan n’ignore nullement le catholicisme de Claudel ni cette contradiction dans les termes que constitue l’hypothèse d’un tragique chrétien, puisque, à la différence du héros antique qui « reçoit la charge de la dette de l’Atè qui le précède » et s’en retrouve « coupable », l’incarnation « ouvre pour nous la possibilité, la tentation où il nous est possible de nous maudire, non pas seulement comme destinée particulière [ce que fait Œdipe dans Œdipe à Colone], comme vie, mais comme la Voie même où le Verbe nous engage, mais comme rencontre avec la vérité, comme heure de la vérité. » L’incarnation justifie le « sacrifi[ce] à la négation de que l’[on]croit. » Car, dans la modernité, le Dieu qui donne sa valeur de vérité à cette situation est mort. C’est même cette mort de Dieu qui est indissociable, pour Lacan, de l’œuvre de Freud, présenté comme le contemporain de Claudel. Lacan en voit le signe le plus manifeste dans L’Otage où le « signifiant » de Dieu – le Pape Pie – et l’âme de Sygne sont « otages », captifs « aux mains de la politique, proie[s] de ceux qui veulent [les] utiliser à des fins de restau- ration ». Lacan insiste donc sur la contradiction de l’héroïsme moderne, « devenir l’Otage du Verbe parce qu’il s’est dit, ou aussi bien pour qu’il se soit dit, que Dieu est mort.» La négation, qu’on l’appelle aussi le refus ou la perdition de Sygne, désigne cette « béance», cette absence, ce vide, ou encore ce néant auquel aspire réellement le désir. La fable tragique est construite autour de cette béance qu’elle historicise et transporte dans le domaine utilitaire de la circulation des biens et des personnes. Le cycle des Coûfontaine forme – et il faut donner à ce verbe le sens esthétique que nous avons rencontré – une « figure du destin, comme on dit aussi bien figure de rhétorique ». Cette lecture du destin de Sygne, Lacan la reconduit autour des personnages de Lumîr et de Pensée. L’ombre de Sygne traverse ainsi l’ensemble du cycle. Claudel en avait le projet secret, lui qui, dans un avant-texte, au début de la scène 2 de l’acte I du Pain dur, faisait s’ouvrir soudainement la porte du réduit secret où le Pape Pie s’était réfugié à l’acte I de L’Otage et suggérait la présence fantomatique de Sygne13. Ainsi c’est à la fois dans le texte théâtral, dans le dispositif scénique, et aussi dans le corps même des personnages que Lacan retrouve la lettre du désir, le signifiant de la Chose ou encore de cet Autre d’où finit par parler le héros14. À force de calembours et de méditations sur l’étymologie, deux formes de pensée et d’écriture qu’affectionnait Claudel15, Lacan donne pour titre à une séance de son séminaire le non de Sygne, la négation recouvrant le nom, le prénom recouvrant le signe. Dans ce prénom que forge Claudel et qu’il substitue durant la copie définitive au prénom de Berthe, certes moins poétique, emprunté à Une ténébreuse affaire de Balzac, Lacan voit l’indice du « signifiant manquant» du désir, et associe cet indice à sa réflexion sur la lettre. La substitution du y au i dans un mot où se lit le signifiant même du signe, conduit Lacan à condenser dans le prénom de l’héroïne tragique « l’imposition du signifiant sur l’homme », « ce qui le marque et le défigure. » La tragédie de Sygne devient ainsi la tragédie de l’humain et de son désir, toujours différé dans le signe, toujours barré, toujours symbolisé, à défaut d’être nommé. Aussi renvoie-t-il son auditoire, prouvant s’il en était besoin sa connaissance du texte claudélien, aux lettres que le dramaturge envoie à Gide où il demande que la Nouvelle Revue française fasse forger un caractère spécial, le U majuscule accentué d’un circonflexe, afin de pouvoir typographier correctement les noms des personnages qui « donnent la réplique ». Claudel placerait sous l’autorité d’un signifiant inédit son cycle tragique – ce qu’il réitèrera dans Le Soulier de satin avec la lettre perdue de Prouhèze à Rodrigue, expression d’un désir contrarié, retardé, différé et différant. Dans L’Otage, Sygne est à la fois celle qui dit non et celle qui est et incarne le non, allant jusqu’à totalement nier de son corps ses paroles et ses actes à l’acte III de la tragédie, puisqu’à l’acte III elle est constamment agitée d’un mouvement de tête qui signifie la négation et puisque, durant son agonie, que ce soit dans le premier état du drame en présence de Badilon ou dans le second état en présence de son époux Turelure, elle s’obstine dans son refus. Celui-ci, Lacan l’interprète comme un refus des valeurs chrétiennes, de la sublimation, et comme la source d’une émotion, qui au-delà de la terreur et de la pitié transporte le spectateur « vers la séquence ultérieure de la trilogie » : « Il y a quelque chose d’autre dans cette image, où les termes nous manquent.» Dans ce tic, comme dans la grimace que fait Turelure mort de peur quand Louis décharge sur lui ses deux pistolets chargés par Lumîr, « plus attentatoire[s] au statut de la beauté que la grimace de la mort et de la langue tirée […] sur la figure d’Antigone pendue quand Créon la découvre», le psychanalyste voit le stade ultime du tragique moderne, qui défigure le héros, lui fait perdre sa beauté et le plonge dans l’abjection. Une autre séance du séminaire s’intitule, fort logiquement, l’abjection de Turelure.
Lacan fait une telle place au tragique dans son éthique de la psychanalyse et dans sa réflexion sur le transfert parce que le tragique est l’essence même de l’existence de l’homme. Il définit l’éthique « le rapport de l’action au désir qui l’habite » et déplace le questionnement kantien de l’universalité des principes et des valeurs au désir même :
« avez-vous agi conformément au désir qui vous habite ? » Il réintroduit ainsi, dans les rapports au prochain, la violence du désir, allant jusqu’à situer Claudel sur un plan semblable à celui de Sade, voire sur un plan où il dépasse Sade. S’il prend l’exemple de la tragédie pour réfléchir sur l’action humaine et sur son sens secret, c’est que « l’éthique de l’analyse n’est pas une spéculation portant sur l’ordonnance, l’arrangement, de ce que j’appelle le service des biens. Elle implique à proprement parler la dimension qui s’exprime dans ce qu’on appelle l’expérience tragique de la vie. » L’évolution même de la tragédie, dont Claudel, et tout particulièrement le cycle des Coûfontaine, représentent le stade extrême, donne une interprétation très pessimiste, très sombre, de la vie, puisque l’être ne trouve son point d’équilibre que dans la mort. Lacan pense le tragique selon une topologie du désir, où Claudel occupe une place – Lacan parle aussi de position, de situation – ultime. Rares sont les autres écrivains français cités par Lacan pour définir ce point extrême de la catégorie de l’abjection. Sygne de Coûfontaine, Turelure, Lumîr, Orian, Orso, Pensée occupent cet espace. Il cite, bien sûr, Sade, et aussi Jean Genêt, Les Paravents, pièce publiée en 1961. Mais il prend ses distances avec deux auteurs contemporains qui commentent Sade. De Georges Bataille, il rejette la lecture qu’il donne de l’érotisme, « tenant sa valeur de nous donner accès à une assomption de l’être en tant que dérèglement», alors que le véritable érotisme, selon Lacan, ne peut provoquer chez le lecteur ou l’auteur que « l’approche d’un centre d’incandescence, ou de zéro absolu, qui est psychiquement irrespirable. » Ce jugement, porté sur Sade, vaudrait pour Claudel, d’autant plus que l’incandescence est très présente dans ses œuvres, L’Échange, Partage de midi, le cycle des Coûfontaine ou Le Soulier de satin. Lacan ironise aussi sur l’absurde dont Albert Camus, prix nobel de littérature en 1957, taxe l’œuvre de Sade.
« L’absurde est une catégorie un petit peu commode depuis quelque temps. Les morts sont respectables16, mais nous ne pouvons pas ne pas noter la complaisance qu’a apportée à je ne sais quels balbutiements sur ce thème le prix Nobel. C’est là une merveilleuse récompense universelle de la knavery [trad. : filouterie], et dont le palmarès est fait des stigmates d’une certaine abjection dans notre culture. » Lacan nous conduit donc à une lecture tout à fait dérangeante de Claudel en introduisant une catégorie synonyme d’abaissement, de dégradation, de rebut, voire de déchet, qui, certes, n’est pas incompatible avec la pensée catholique – une compatibilité que refuserait Lacan, évidemment. Lacan voit donc en Claudel un des représentants les plus aboutis du refus de l’humanisme littéraire et académique – ce qui ne lui aurait pas nécessairement déplu :
« Le redoutable inconnu au-delà de la ligne, c’est ce que, en l’homme, nous appelons l’inconscient, c’est-à-dire la mémoire de ce qu’il oublie. Et ce qu’il oublie – vous pouvez voir dans quelle direction – c’est ce à quoi tout est fait pour qu’il ne pense pas – la puanteur, la corruption toujours ouverte comme un abîme – car la vie, c’est la pourriture. »
Cette interprétation de Claudel par Lacan, que l’on soit plus ou moins réticent à la psychanalyse freudienne et son école, impose au moins deux conclusions qui sont incontournables, deux invitations à relire l’œuvre dans son ensemble.
Si le théâtre de Claudel parle aux générations du XXe et du XXIe siècles, ce n’est pas seulement pour son romantisme, ni pour la foi catholique qui le porte : le spectateur écoute et regarde en oubliant tout de sa vie morale, sociale et économique soumise à la loi – l’adultère, le détourne- ment de fonds, le vol, la paresse – tandis que l’acteur ou l’actrice et leur texte « entre[nt] dans leur âme comme dans une maison vide», se font l’image et le signifiant de leur désir. Ce n’est pas Lacan qui l’affirme : c’est bien Claudel17. Il suffit de relire avec attention le texte claudélien pour vérifier l’efficacité des propositions lacaniennes, pour être confronté à des formulations scandaleuses, par exemple les pages qu’il consacre au prochain et à l’amour du prochain, ou d’autres drames que ceux du cycle des Coûfontaine. « Que se passe-t-il chaque fois que sonne pour nous l’heure du désir ? » Cette question posée dans le séminaire nous renvoie à l’incipit de Partage de midi, aux « Huit coups sur la cloche », à la lumière qui rend chacun « horriblement visible » et au « beau » spectacle de la mer – la mise à mort de la vache sacrée par son dieu :
Cette fois ce n’est plus son amant, c’est le bourreau qui la sacrifie ! Ce ne sont plus des baisers, c’est le couteau dans ses entrailles !
Et face à face elle lui rend coup pour coup18.
Ce midi qui retentit sur le bateau, c’est l’heure du désir : on sait l’importance que prend dans la pensée claudélienne cette notion d’heure. Avec elle vient le moment du bilan de soi dans la mort, pour chacun des personnages, de sa satisfaction ou de sa non-satisfaction, du sentiment d’être en vie ou d’être dans la mort. Mesa déclare : « Qu’il est redoutable de finir d’être vivant19 ! » Cette articulation du désir et de la mort domine l’ensemble de l’acte II où nous voyons les deux amants s’aimer – il faut donner à ce verbe tout son sens érotique – dans « le cimetière plein d’arbres touffus de Happy Valley20. » Je rappellerai ces paroles d’Ysé :
Mais ce que nous désirons, ce n’est point de créer, mais de détruire, et que ah !
Il n’y ait plus rien d’autre que toi et moi, et en toi que moi, et en moi que ta possession, et la rage, et la tendresse, et de te détruire et de n’être plus gêné Détestablement par ces vêtements de chair, et ces cruelles dents dans mon cœur,
Non point cruelles !
Ah, ce n’est point le bonheur que je t’apporte, mais ta mort, et la mienne avec elle,
Mais qu’est-ce que cela me fait à moi que je te fasse mourir […]21
Claudel donne ainsi un superbe exemple de la parole tragique qui lui est propre : le personnage dicte son destin, qui s’accomplira à l’acte III, lui-même dominé par le désir de mort, et tellement semblable en sa structure à l’acte III de L’Otage.
La seconde conclusion est indissociable de la première. Le théâtre de Claudel n’est pas moderne – évitons cette épithète trop galvaudée et qui n’a plus guère de sens. Il est actuel, au sens où il parle à chacun de son être. Lacan inscrit bien cette actualité dans le contexte historique du XXe siècle et du XXIe siècle, dominés par la mort de Dieu, nous l’avons vu. Voilà qui est évidemment tout à fait paradoxal s’agissant de Claudel, un auteur catholique. Il resterait à comprendre quel sens est donné à ce paradoxe et quelle part il prend au tragique de Claudel. Lacan fonde sa lecture sur le Malaise de la civilisation de Freud et sur le mythe du meurtre du père, Totem et tabou, pour donner consistance à cette mort de Dieu. Celle-ci signifierait le renforcement de la loi, des préceptes et des interdits, du signifiant : « Sans la loi, la Chose est morte. […] En effet je n’aurais pas eu l’idée de la convoiter si la Loi n’avait dit – Tu ne la convoiteras pas. » En raison même du commandement qui rend séduisante toute transgression et désirable tout franchissement de la limite, l’homme devient « désir de mort». C’est pourtant bien, au cœur même de ce retournement paradoxal, que Lacan rejoint Claudel. Car le psychanalyste retourne, tout à fait sciemment, l’Épître aux Romains de saint Paul, chapitre 7, paragraphe 7, centrale dans la pensée dogmatique de Claudel. « Je pense que, depuis un tout petit moment, certains d’entre vous au moins se doutent que ce n’est plus moi qui parle. En effet, à une toute petite modification près – Chose à la place de péché – ceci est le discours de saint Paul concernant les rapports de la loi et du péché». (Ibid.) Claudel intéresse Lacan pour ce dialogue – tragique – qu’il mène avec la loi et avec la religion catholique.
Didier Alexandre
Sorbonne Université
