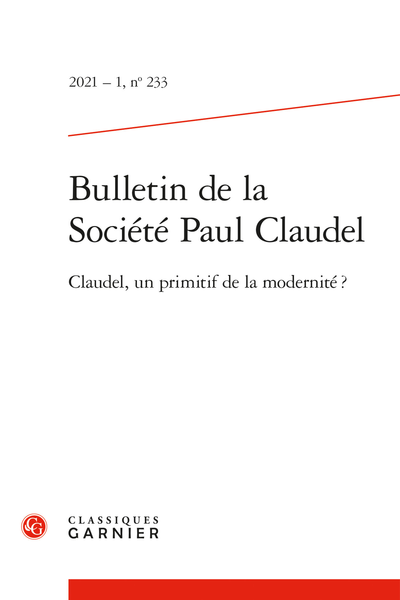Sommaire
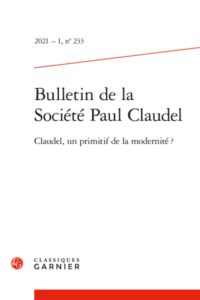
Olivier Belin et Anne-Claire Bello
Claudel, un primitif de la modernité ? /
Claudel, a primitive of modernity?, 9
Anne-Claire Bello
Entretien avec Sylvie Germain à propos de Paul Claudel /
Interview with Sylvie Germain on Paul Claudel, 15
Anne-Claire Bello
Paul Claudel et Sylvie Germain, deux primitifs de la modernité ? /
Paul Claudel and Sylvie Germain, two primitives of modernity?, 21
Flora Souchard
« Les animaux à l’œuvre sur le monde ». La bestialité chinoise de Connaissance de l’Est /
“Animals at work on the world”. The Chinese bestiality in Connaissance de l’Est, 37
Thomas Bruckert
De quelques personnages indisciplinés chez Claudel /
The drama disrupted by the stage. About some of Claudel’s unruly characters, 53
Olivier Belin
La faute à Claudel. Esquisse d’une poétique de l’incorrection /
Claudel’s mistake. Sketch of a poetics of incorrectness, 65
EN MARGE DES LIVRES / BOOK REVIEWS
Marie-Victoire Nantet, Camille et Paul Claudel. Lignes de partage (Claude-Pierre Pérez), 83
Jacques Julliard, De Gaulle et les siens, Bernanos, Claudel, Mauriac, Péguy (Catherine Mayaux), 85
ACTUALITÉ / NEWS
Chantal Boiron
De l’ombre à la lumière. La Messe là-bas dite par Didier Sandre 91
ANNONCES / ANNOUNCEMENTS
Le Soulier de satin à l’Opéra Garnier /
Le Soulier de satin at the Opéra Garnier, 97
Rencontres de Brangues 2021 /
The Rencontres de Brangues 2021, 99
Renée Nantet, 101
Résumés/Abstracts, 103
LA FAUTE À CLAUDEL
Esquisse d’une poétique de l’incorrection
CLAUDEL CONTRE LA GRAMMAIRE
La première moitié du XXe siècle aura été, comme nous l’a appris Gilles Philippe, le « moment grammatical » de la littérature française1, celui où la grammaire est venue à la rencontre de la pratique littéraire, et où le travail du style s’est accompagné d’une profonde réflexion des écrivains sur la langue, la phrase, le lexique, la syntaxe ou la norme linguistique.
Si l’œuvre claudélienne participe de cette convergence entre grammaire et littérature, elle le fait d’une manière à la fois singulière et paradoxale. En matière grammaticale, Claudel invalide en effet la norme au profit de l’usage, et considère que la langue poétique, loin de rompre avec la langue ordinaire ou avec l’oralité commune, en constitue le prolonge- ment, jusqu’à accueillir leurs audaces ou leurs irrégularités. De la parole vive des locuteurs populaires à la voix du sujet lyrique ou au discours des personnages dramatiques, il n’y aurait donc aucune solution de continuité, mais une même tendance à l’incorrection – si l’on veut bien entendre ce terme, littéralement, comme un refus de corriger « l’état sauvage2 » de la langue ou de polir les aspérités du style. L’incorrection, en ce sens, ne désigne pas un défaut ou une transgression : elle signale l’énergie foncière et première du langage, incarné dans une parole rétive à toute normalisation et encline à subordonner les règles de la syntaxe à l’expressivité du rythme. Hostile au poids de la norme et à la fixité de l’écrit, la pensée grammaticale de Claudel invite ainsi à ébaucher une poétique de l’incorrection où la faute, loin d’apparaître comme une entorse, une erreur ou une lacune, signifierait la réticence du sujet parlant à prendre le pli de la langue écrite, telle qu’elle a été transmise par les manuels scolaires et magnifiée par le mythe de la clarté française. À cet égard, les travaux d’Emmanuelle Kaës ont définitivement situé et éclairé les positions claudéliennes sur la langue en général, et la grammaire en particulier. En accord avec les orientations qui, au tournant du XXe siècle, se sont dégagées de la linguistique de Ferdinand de Saussure et de son disciple Charles Bally, Claudel fait de l’oralité le terreau vivant de la langue :
C’est le primat absolu de la langue parlée sur la langue écrite qui fonde le libéralisme grammatical de Claudel : puisque rien n’existe dans la langue qui n’ait d’abord été dans les réalisations concrètes de la parole, la langue ne peut être légitimement constituée en norme ou en loi par rapport à quoi se mesureraient les « fautes » du discours. Par conséquent, du strict point de vue de la norme grammaticale, on peut poser que pour Claudel, tout peut se dire, le seul principe régulateur qu’il admette étant l’usage3.
Cette attitude radicale, qui se déploie surtout durant l’entre-deux-guerres, tient aussi au contexte polémique dans lequel elle se construit. Ses positions linguistiques et grammaticales, Claudel les formule en effet en réponse aux sévères critiques émises contre son style et contre sa langue, précisément accusés d’incorrection par les défenseurs d’une esthétique néo-classique. Deux titres sont, de ce point de vue, significatifs. La monographie du Père Joseph de Tonquédec (L’Œuvre de Paul Claudel, 1917) reproche ainsi à Claudel l’obscurité de son style, le bariolage de son vocabulaire et ses manquements aux règles de la syntaxe, qui aboutissent selon lui à une langue difforme. Puis, en 1920, c’est au tour de Pierre Lasserre, ancien critique littéraire de l’Action française et auteur en 1907 d’une thèse virulente contre le romantisme français, d’attaquer la langue et la syntaxe claudéliennes dans le premier chapitre de ses Chapelles littéraires : Claudel y est blâmé pour sa « façon non française d’user du français », pour la manière dont il maltraite « la correction élémentaire » de la phrase, et plus généralement dont il s’éloigne du génie de la langue française, cet « instrument de conservation de notre civilisation4 ».
Purisme linguistique, vision normative des règles grammaticales, essentialisation d’un français identifié à l’expression de la clarté et de la raison : tels sont quelques-uns des présupposés que Claudel invalide chez ses censeurs afin de défendre la légitimité – et la francité – de sa propre langue littéraire. C’est aussi dans cette perspective qu’il faut comprendre la contestation de la notion même de faute. À une critique néo-classique et traditionaliste qui juge sévèrement les libertés de sa syntaxe et la bigarrure de son langage poétique et théâtral, Claudel oppose l’éloge de l’usage, l’intérêt pour l’oralité vue comme la vie même de la langue, la critique du pédantisme grammatical, le refus du corset normatif. On le voit, la défense de Claudel va au-delà d’un plaidoyer pro domo : elle passe par une déconstruction des arguments adverses et implique une pensée de la continuité qui fait de l’expression littéraire, comme le note E. Kaës, « une exemplification de la langue commune, de son potentiel expressif, de son incorrection parfois5 ». La portée de ces réflexions est considérable, et subversive à bien des égards. Car si les écarts constituent la norme, alors la notion de faute se dilue dans un relativisme généralisé de la parole, et le style littéraire lui-même n’est qu’un écart parmi d’autres, participant en cela de la vitalité générale d’une langue sans cesse inventée par ses locuteurs.
FONCTIONS ET VALEURS DE LA FAUTE
C’est dans la 22e des « Réflexions et propositions sur le vers français » (1925) que la valeur de la faute est mise en évidence. Pour en arriver là, Claudel redéfinit d’abord ce qu’est pour lui la grammaire, et ce qu’elle aurait dû rester : « la constatation et recommandation prudente de l’usage le plus général et le musée des formes délicates de l’idiome6 ». À cette grammaire descriptive, Claudel oppose la tradition de la grammaire normative, disqualifiée pour avoir été « fabriquée par des gens de cabinet qui avaient perdu le sens de la langue parlée et qui avaient en vue l’expression logique de la pensée et non pas son expression vivante et délectable7 ». Le primat de l’usage et de l’oralité conduit alors Claudel à légitimer « des expressions attestées sans relâche depuis le baptême de Clovis » et des « gallicismes naïfs8 » : des expressions comme pareil que, des locutions comme des fois que, la présence du conditionnel après si… La fréquence et la persistance de ces tournures, en dépit de toutes les condamnations, acquièrent ainsi la force d’un état de fait.
Non content de justifier la faute en fait, Claudel la fonde en droit. À ses yeux en effet, elle relève d’une nécessité inhérente à la voix, à la dynamique du rythme et à l’expressivité de la parole. Le poète inverse ainsi l’axiologie de la grammaire normative, situant la norme du côté de l’entrave, de la sclérose ou de la langueur, et l’incorrection du côté du mouvement, de l’ouverture et de la vie : ainsi les prétendues fautes ne sont qu’une réponse aux « besoins les plus authentiques de l’âme qui cherche ouverture9 » en se frayant un chemin parmi les phrases, les mots et les sons. Car c’est bien, en dernier ressort, à une exigence d’ordre euphonique que répond la faute ; là où les pédants ne voient qu’une ignorance ou une transgression, Claudel discerne une vocalité agile et inventive :
Ce qu’on appelle une faute de français est le plus souvent le mouvement instinctif du langage qui cherche un chemin de traverse pour éviter le détour, l’obstacle ou la cacophonie que les pédants opposent à sa marche. La faute grammaticale est le plus souvent le remède à une faute euphonique10.
Comme l’a montré E. Kaës, Claudel témoigne ici d’une « approche fonctionnaliste de la faute de grammaire11 ». Cette vision claudélienne converge avec les travaux d’Henri Frei qui, dans La Grammaire des fautes (1929), explique les fautes par l’adaptation des structures de la langue aux cinq besoins fondamentaux qui régissent l’activité du sujet parlant : besoin d’assimilation (pour favoriser la cohésion du discours, par exemple avec les accords de proximité), de différenciation (avec des procédés redondants ou pléonastiques qui visent à éviter l’ambiguïté), de brièveté (grâce, entre autres, à l’ellipse), d’invariabilité (pour neutraliser la multiplicité des options grammaticales, comme en témoigne la tendance de que à devenir une conjonction passe-par- tout) et d’expressivité (quand le locuteur entend marquer l’intensité de sa parole).
C’est évidemment à ce besoin d’expressivité que Claudel rattache la faute. Comprise comme une création signifiante à l’intérieur des possibles du système linguistique, celle-ci peut alors devenir l’un des lieux où affleure une stylistique. Mais Claudel traite aussi, et avant tout, la faute en poète. C’est pourquoi il la rapporte à deux besoins ignorés de Frei. Le premier est en quelque sorte un besoin euphonique (ou rythmique), d’autant plus vital que l’oralité constitue pour Claudel l’expérience fondamentale de la langue. Ce besoin euphonique apparaît, à l’état natif, dans la banale conversation entre deux dames qu’un autre passage des « Réflexions et propositions » compare à un chant d’oiseau, à une pure vocalise détachée du carcan grammatical : « Quelles élégantes ondulations de la phrase ponctuée au mépris de la grammaire et que termine un cri de fauvette12 ! »
Le second besoin suggéré par Claudel pourrait être qualifié d’énergétique ou de cinétique. Il s’agit ici de faciliter la course de la parole, d’augmenter la force de sa profération, d’assurer sa fluidité en déjouant tout obstacle. Cette conception cinétique de la langue affleure également dans la définition que Claudel, abordant la poésie romantique, donne de la phrase, elle qui est censée
entraîner l’auditeur en créant un courant puissamment nourri d’images qui va, d’une force accélérée par le poids et rendue plus sensible encore par le passage régulier des rimes, vers une résolution que la passion désigne et que le cœur appelle13.
Loin donc d’être une maladresse, l’incorrection agit comme un court-circuit qui fait rendre au langage un surplus d’intensité et d’expressivité, là où l’application de la règle ou l’obéissance à la norme auraient occasionné une déperdition d’énergie et d’efficacité poétiques. Une argumentation analogue, mais transposée sur la scène théâtrale et dans un registre à la fois ironique et satirique, parcourt la scène ii de la troisième Journée du Soulier de satin. Don Léopold Auguste, le docte pédant qui embarque pour le Nouveau Monde par « amour de la grammaire » et par désir de corriger le castillan dégénéré des Espagnols ultramarins, s’en prend comiquement à ce nouveau langage dans lequel il ne voit qu’abâtardissement, incorrection et « licence épouvantable » :
Qu’est-ce qui se passe là-bas ? qu’est-ce qui arrive au castillan ? Tous ces soldats à la brigande lâchés tout nus dans ce détestable Nouveau Monde,
Est-ce qu’ils vont nous faire une langue à leur usage et commodité sans l’aveu de ceux qui ont reçu patente et privilège de fournir à tout jamais les moyens d’expression14 ?
Incarnation des « Philaminte» et des « Trissotin» que Claudel raille dans les « Réflexions et propositions sur le vers français15 », professeur borné qui corrige et châtie le langage de ses contemporains plutôt que de le comprendre, Don Léopold Auguste est affecté d’une intolérance maladive à la faute, comme il l’avoue sans fard : « On m’a donné à lire leurs copies, je veux dire leurs mémoires, dépêches, relations comme ils disent. Je n’arrêtais pas de marquer des fautes16 ! » Les incorrections qu’il souligne (usage de mots grossiers, barbarismes, mélange des registres) sont précisément celles que pointait contre Claudel un critique comme P. Lasserre, qui devient, dans la bouche de Léopold, « le professeur Pedro de las Vegas, plus compact que le mortier», autorité suprême des pédants et défenseur acharné de la tradition – du nouveau aussi, mais pourvu qu’il soit « exactement semblable à l’ancien17 ». Au-delà du règlement de comptes, le personnage de Don Léopold Auguste permet à Claudel, par un habile jeu de miroirs, de réaffirmer ses propres arguments linguistiques, mais du point de vue d’un grammairien ridicule qui s’offusque de ces principes hétérodoxes. L’idée que la faute de syntaxe, en particulier, n’est au fond qu’un raccourci expressif qui fait sauter les digues normatives pour favoriser le flux de la parole, reprend ainsi la métaphore cinétique présente dans les « Réflexions et propositions sur le vers français » :
Et cette manière de joindre les idées ! la syntaxe pour les réunir a combiné maint noble détour qui leur permet peu à peu de se rapprocher et de faire connaissance.
Mais ces méchants poussent tout droit devant eux et quand ils ne peuvent plus passer, ils sautent18 !
La ligne droite contre le détour, l’ouverture contre l’obstacle, le saut contre l’enlisement : tels sont les motifs que Claudel, dans son essai comme dans sa pièce, déploie pour revaloriser la faute, comprise comme une véritable dynamique de la parole là où les normes du français scolaire ou néo-classique constituent des entraves. Les « Réflexions et propositions » font également jouer en ce sens l’axiologie du lourd et du léger, du rectiligne et du tortueux, du droit et du maladroit :
En vain la grammaire voudrait nous imposer comme correctes d’imprononçables bouillies, le bourbeux Je pars pour Paris, au lieu du direct et prompt Je pars à, l’encombrant L’homme ne vit pas seulement de pain, au lieu de L’homme ne vit pas que de pain, des freins claqués comme bien que ou quoique au lieu du solide malgré que, qui grippe et grince à la perfection19.
Contre toute attente, la faute peut donc être élégante, au sens où l’on parle de l’élégance d’une démonstration mathématique, lorsqu’elle va droit à la solution avec économie, netteté et clarté. Certains tours claudéliens illustrent particulièrement cette paradoxale élégance de l’incorrection, qui rompt la construction attendue de la phrase pour créer une nouvelle continuité entre les éléments qui la composent. À l’ouverture de Tête d’Or par exemple, le « j’ai plein mon cœur d’ennui20 ! » lancé par Cébès tire sa force expressive de l’antéposition de l’adjectif plein et de la redondance des marques de l’énonciateur, avec le pronom je et le déterminant possessif mon : l’apparente maladresse et la perturbation de l’ordre normal de la proposition, tout en retrouvant la verdeur d’une expression familière comme en avoir plein le dos, permettent alors au personnage d’exprimer l’excès de douleur qui l’accable, tout en se conformant à l’image de l’« imbécile» et de l’« ignorant21 » sous laquelle il vient se présenter au public.
Qu’il y ait du reste un génie de l’ignorance, et que les raccourcis énergiques du parler familier s’avèrent nécessaires pour le donner à entendre, c’est ce qu’affirme avec plus d’éclat encore « L’esprit et l’eau », cette ode où le sujet lyrique, à la différence du personnage de Cébès, affirme la plénitude en lui de la présence divine :
Je sens, je flaire, je débrouille, je dépiste, je respire avec un certain sens La chose comment elle est faite ! Et moi aussi je suis plein d’un dieu, je suis plein d’ignorance et de génie22 !
Tout se passe alors comme si l’incorrection syntaxique, loin de s’apparenter à un manque ou à une lacune de l’expression, marquait au contraire l’excès d’une plénitude intérieure, l’énergie débordante d’un sujet ardemment ouvert sur le monde, et qui désapprend à parler pour essayer de retrouver le langage même de la création. C’est pourquoi Polymnie, la « Muse du poëte», est présentée comme une voix « pleine d’amour » qui répète la parole de Dieu, puis « comme un petit enfant qui épelle “Qu’elle est” », autrement dit la formule même de la Genèse, et enfin comme une « servante de Dieu, pleine de grâce » qui cherche elle aussi à remettre la Création en mots : « tu contemples chaque chose dans ton cœur, de chaque chose tu cherches comment la dire23 ! » Si une poésie naïve et primitive cherche à se dire chez Claudel, c’est donc bien dans le sens étymologique de ces adjectifs : il s’agit de proférer une parole native et première, à l’exemple de l’enfant qui explore et exploite les possibles du langage, sans égards pour le dressage grammatical dont il va être l’objet à l’école.
Ces extraits de Tête d’Or et des Odes intègrent la faute de grammaire dans un mouvement de régression linguistique qui n’est que la contrepartie d’un mouvement inverse de progression dans la co-naissance du monde et de la parole. On comprend dès lors le rôle d’une poétique de l’incorrection : il ne s’agit pas de mettre des formes, mais de traduire des forces, de traduire un trop-plein d’énergie que la vivacité de l’oral parvient à exprimer, mais que les règles de l’écrit ne sauraient saisir au vol. À vrai dire, cette poétique de l’incorrection ne repose pas uniquement sur la transgression des normes grammaticales ; elle tient plus largement, comme l’a montré E. Kaës à propos de l’œuvre théâtrale24, à l’invention d’une langue composite où se mélangent des archaïsmes, des régionalismes, des latinismes, ainsi que des termes argotiques ou parfois grossiers. On peut en trouver un éloquent témoignage dans la dernière version de L’Annonce faite à Marie, avec des tournures patoisantes ou familières comme « Quoi qu’i font les ceusses ed là-bas ? » ou « I fait bin froid pour promener les tiots enfants à c’t’heure25 ». Si la parole paysanne et populaire est présente dès les premiers drames claudéliens, la réécriture tardive de certaines pièces constitue le point culminant de cette tendance à l’incorrection, qui se déploie de manière spectaculaire dans On répète Tête d’Or (1949), qui fait rejouer le drame symboliste de la jeunesse de Claudel par des prisonniers de guerre français dans un Stalag. Le lyrisme de la première version de la pièce se trouve ainsi contesté et contrasté par des répliques comme « T’as une femme ; Quel âge q’t’avais quand tu l’as mariée ? », ou bien « S’en fout’ pas mal de penser à nous, les aut’, ceux de là-bas, leur manque rien, s’en fout’ pas mal qu’on se mange les foies ici à se manger le cœur26 ! »
À ce degré de réinvestissement poétique et langagier, peut-on encore même parler d’incorrections ou de fautes ? Le primat de l’usage défendu par Claudel conduit en effet à la conclusion paradoxale que la faute n’existe pas. Car dès lors que ce sont les usages qui font la règle, comment un usage pourrait-il transgresser une règle quelconque ? Si une langue ne vit qu’à travers la somme de ses réalisations orales, de ses irrégularités quotidiennes autant qu’ancestrales, de ses dialectes, de ses sociolectes et de ses idiolectes, alors la faute de syntaxe se comprend comme une figure de style : une généralisation de l’anacoluthe, en somme. Quant aux barbarismes ou aux solécismes, ils ne constitueraient au fond que des idiotismes, des façons de parler ou plutôt de faire parler la langue, en déployant ses potentialités poétiques, rythmiques et expressives.
Pourtant, la faute selon Claudel ne se résorbe pas entièrement dans la relativité des usages et dans le refus du purisme ou du dogmatisme linguistiques. Les « Réflexions et propositions sur le vers français », par exemple, la conservent tout en la déplaçant de l’ordre grammatical vers l’ordre euphonique et rythmique. C’est ce dont témoigne la légère faute que Claudel, avec toute son admiration pour Bossuet, ne peut s’empêcher de relever dans la phrase suivante, tirée des Méditations sur l’Évangile et scandée par ses soins : « La béatitude éternelle leur est promise – sous le titre majestueux de royaume27. » La faute, ici, ne consiste pas en un vice de construction, mais en une dissonance dans la distribution des timbres et des accents de la phrase, comme l’indique Claudel : « La faute est que le premier temps fort ne pouvant porter sur nelle (à cause de l’l initial du mot suivant) est rejeté en quelque sorte sur le blanc28. » En redéfinissant ainsi la faute comme une chute d’intensité, un relâchement du rythme ou de la mélodie de la phrase – du phrasé, serait-on tenté de dire –, Claudel ne fait au fond que tirer les conséquences du primat de l’oralité dans sa conception de la langue.
Mais dans cette poétique de l’incorrection, la faute conserve aussi un sens en tant que faute, comme acte de subversion, de transgression, de défi. De là à faire le lien avec la faute au sens théologique, il n’y a qu’un pas que Christèle Barbier, dans son étude de la langue du Soulier de satin, invite à franchir en rappelant que « dans l’imaginaire claudélien, la faute est consubstantielle au monde », et que « le vers comme la faute manifestent le péché de la créature qui s’abîme dans le néant et la coopération du péché à l’œuvre de Création29 ». Qu’elle prenne la forme de l’erreur syntaxique, de l’abus lexical ou du péché, la faute relève en effet d’un dérèglement originel dont l’énergie, bien que déstabilisante, participe d’un véritable bouillonnement créateur. C’est d’ailleurs sous le signe du désordre, ce « délice de l’imagination », que se place le prologue du Soulier de satin, avec des indications de mise en scène qui insistent sur les vertus de l’à-peu-près : « Il faut que tout ait l’air provisoire, bâclé, incohérent, improvisé dans l’enthousiasme ! » Dans ce drame aux dimensions cosmiques, l’erreur fait partie du jeu, et ce qui est vrai pour les décors l’est aussi pour les acteurs : « S’ils se trompent, ça ne fait rien30. » Dieu lui-même, selon le proverbe portugais cité en épigraphe, « escreve direito por linhas tortas31 » : renonçant à la formule consacrée en français (« les voies du Seigneur sont impénétrables »), Claudel retrouve par le biais d’un idiome étranger le lexique du droit et du tortueux qui caractérisait aussi sa description de la faute de grammaire.
L’INCORRECTION : UN HORIZON PRIMITIVISTE ET MODERNISTE
En donnant une fonction et une valeur à la faute, Claudel lui confère surtout un sens littéraire, qui contribue à définir sa position singulière.
L’éloge de l’incorrection lui permet ainsi, on l’a vu, de se démarquer des positions puristes et conservatrices d’un Tonquédec ou d’un Lasserre, et plus largement du néo-classicisme de l’Action française32. Mais en malmenant la grammaire, Claudel s’accorde aussi une audace linguistique dont les avant-gardes révolutionnaires, de l’autre côté du spectre politique, ne font pas toujours preuve : qu’on songe ici à Breton demandant d’observer la syntaxe jusque dans le poème obtenu dans le Manifeste du surréalisme par collage d’énoncés prélevés dans les journaux33. En somme, c’est aussi par son traitement particulier de la faute que Claudel prend place dans une modernité poétique qui ne se définit pas seulement par sa force de subversion, mais aussi par son élan primitiviste vers l’oralité, l’enfance, le peuple ou l’ignorance, ces figures de l’originel. Mettre en œuvre une poétique de l’incorrection revient alors, pour Claudel, à « trouver une langue », selon le mot utilisé par Rimbaud dans sa « Lettre du Voyant34 », et une langue retrempée aux charmes de ces irrégularités qu’énumère le début d’« Alchimie du verbe » : « littérature démodée, latin d’église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeules, contes de fées, petits livres de l’enfance, opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs35 ». La réflexion de Claudel sur la faute, au-delà d’une position singulière, participe ainsi d’un horizon esthétique moderne qui, loin de privilégier la rupture ou la défamiliarisation, opte pour la continuité entre le langage poétique et la langue commune, avec ses usages et ses erreurs. Ce continuisme littéraire pourrait trouver des antécédents dans le romantisme, comme en témoigne l’attachement de Nerval aux chansons et légendes du Valois, à l’époque où les publications folkloristes commencent à battre leur plein. Évoquant ces chansons, Nerval y entend certes « des vers composés sans souci de la rime, de la prosodie et de la syntaxe», mais c’est pour mieux souligner que « la langue du berger, du marinier, du charretier qui passe, est bien la nôtre, à quelques élisions près, avec des tournures douteuses, des mots hasardés, des terminaisons et des liaisons de fantaisie ». Cette langue populaire et familière, loin d’être erratique, possède « ses règles, ou du moins ses habitudes régulières », à tel point que Nerval, fonctionnaliste avant l’heure et claudélien avant Claudel, voit dans une liaison fautive comme « J’ai z’un coquin de frère » un remède euphonique à « un hiatus terrible », et vante les bénéfices sonores de « ce z si commode, si liant, si séduisant36 ».
Parmi ses contemporains cette fois, Claudel l’« antigrammairien37 » trouverait un répondant sans doute moins attendu en la personne d’Aragon, dont le Traité du style (1928) se lit en partie comme une virulente attaque contre les règles de grammaire et de syntaxe. Le prière d’insérer de la première édition du livre fait l’éloge provocateur des « fautes de français, faites délibérément dans l’espoir d’obtenir [du] lecteur les plaisants hurlements qui légitiment son existence38 ». De manière tout aussi véhémente, au début de son traité, Aragon affirme qu’il « piétine la syntaxe parce qu’elle doit être piétinée », revendiquant « les phrases fautives ou vicieuses », « l’inattention à la règle » ou encore « les périodes à dormir debout boiteuses39 ». Comparant la syntaxe à du raisin, Aragon suggère, à sa manière, les vertus expressives de l’incorrection : car piétiner la syntaxe comme on foule du raisin, c’est littéralement permettre au langage de s’exprimer – de lui faire rendre tout son jus. À l’instar de Claudel encore, Aragon déplace les critères du correct et de l’incorrect. Tout en reconnaissant que les récits de rêve ou les textes automatiques doivent « être bien écrits », il refuse en effet d’assimiler ce souci du style à un polissage de l’écriture, et le caractérise par l’image très claudélienne de la rectitude et du mouvement : « Bien écrire, c’est comme marcher droit40. » Et chez Aragon comme chez Claudel, cette sensibilité à la dynamique du langage tient au primat de l’oralité : le Traité du style postule en effet que les mots « portent sens dans chaque syllabe, dans chaque lettre », et privilégie un mode de pensée qui repose sur l’« épellement de mots qui conduit du mot entendu au mot écrit41 ». Ces positions communes, par-delà les querelles littéraires qui opposent Claudel aux surréalistes durant l’entre-deux-guerres, expliquent sans doute en partie le dialogue que les deux auteurs établiront entre eux après la Libération.
Enfin, dans ce « moment grammatical» qui aura vu tant d’écrivains français penser leur langue et leur style avec les outils de la grammaire, la figure de Valery Larbaud offre un point de comparaison intéressant avec les réflexions de Claudel. Lecteur des grands linguistes et philo- logues du XIXe siècle et du début du XXe siècle (Franz Bopp, Michel Bréal, Ferdinand Brunot), écrivain, voyageur et traducteur que son polyglottisme rend sensible à la relativité et à la sonorité des idiomes, Larbaud s’en prend lui aussi, dans Sous l’invocation de saint Jérôme, aux « prétentions des puristes » de la langue française, « souvent entachées de préjugé national, de ce nationalisme étroit qui est plus dangereux pour l’essentiel de la culture que la plus rustique et la plus farouche ignorance ». Pour lui, forger une langue littéraire implique au contraire de donner « un “air étranger” à ce qu’on écrit, d’être, en somme, aussi ξενιχὀs [xenikos, étranger] que possible tout en restant clair42 ». Dès lors, l’idée même d’une pureté et d’une fixité de la langue ne fait guère de sens : non seulement parce que les différentes langues se nourrissent d’échanges et de parentés (le latin, en particulier, apparaît à Larbaud comme « la clé de quatre langues étrangères et vingt dialectes », comme le ciment de « toutes les nations de la Chrétienté» et comme le moule qui « fait du Français un Européen, et transforme le provincial en homme du Monde43 »), mais aussi parce que les variations diachroniques, diatopiques, diastratiques ou diaphasiques viennent complexifier l’unité et l’identité de chaque langue.
Lorsque Larbaud réfléchit à la notion de faute, il le fait délibérément en tant que lettré et savant, précisément afin d’intégrer l’incorrection lexicale ou syntaxique dans une approche compréhensive et extensive de la langue littéraire. Dans son ironique « Lettre aux imprimeurs », il se présente en « licencié ès lettres » pour défendre le bien-fondé des fautes volontaires que les typographes ont corrigées dans sa traduction d’Erewhon de Samuel Butler, et pour réfléchir plus largement aux « fautes dues, non au manque, plutôt à l’excès d’instruction » : Larbaud comprend dans cette catégorie les « fautes d’accord, qui viennent de la rapidité de la pensée et de l’écriture », les « fautes de graphies, qui viennent de la familiarité de la pensée avec d’autres langues, anciennes ou étrangères », ainsi que « les néologismes, les déformations et incorrections intentionnelles44 » qui sont le propre de la création littéraire. L’éloge de l’incorrection comme invention poétique et résurgence de l’esprit profond d’une langue converge d’autant plus avec la pensée claudélienne que Larbaud partage un même dégoût pour « le français officiel et courant de la IIIe République, que nous mettons tous nos soins à ne pas écrire45 ». C’est cependant dans une lettre du 20 mars 1933 à Paulhan que Larbaud affirme avec le plus d’éclat et de désinvolture son détachement des normes orthographiques46 : « Il faut bien avoir l’air de respecter l’horthograffe. Cependant j’ai l’impression que je la sais de moins en moins et que je la méprise de plus en plus. » Après avoir cité quelques exemples savoureux de graphies fantaisistes, tirés de ses connaissances bourbonnaises, Larbaud se hasarde à voir « un signe de renaissance littéraire dans ce phénomène», et à en tirer la maxime suivante : « Le mépris de l’orthographe est le commencement de la Poésie. Seulement, il faut que les fautes soient vraies, naturelles, pas faites exprès ; c’est-à-dire qu’il faudrait désapprendre… »
Désapprendre sa langue pour la parler et l’écrire en primitif : c’est là, sans doute, un vœu de lettré, en même temps qu’un rêve moder- niste. La posture contradictoire que perçoit ici Larbaud pourrait se retrouver dans la manière dont Aragon entend piétiner la syntaxe pour néanmoins sauver le style, et dont Claudel exalte la créativité des locuteurs ordinaires tout en recherchant pour sa part, comme le note E. Kaës, « un “haut langage” caractérisé par la complexité syntaxique, l’ampleur rythmique, la richesse des dispositifs analogiques47 ». Pour parvenir à résoudre le paradoxe d’une poétique de l’incorrection, il faut ainsi penser une continuité entre la langue littéraire et la langue populaire, entre le style et l’usage, entre le poète qui cherche sa voix et l’enfant qui apprend à parler ; il faut aussi référer la langue non pas à un système de règles et de normes, mais à un besoin d’expressivité qui, par-delà la dispersion babélienne, relève d’un mouvement vital universellement partagé. La poétique de Claudel, sur ce point, invite à penser les conditions de possibilité d’un catholicisme linguistique, ou d’une linguistique catholique48.
Olivier Belin