• Sommaire
• Sarah Barbedette : « Une mélodie au-delà du souffle ». Entretien avec Marc-André Dalbavie
• Bibliographie
Sommaire
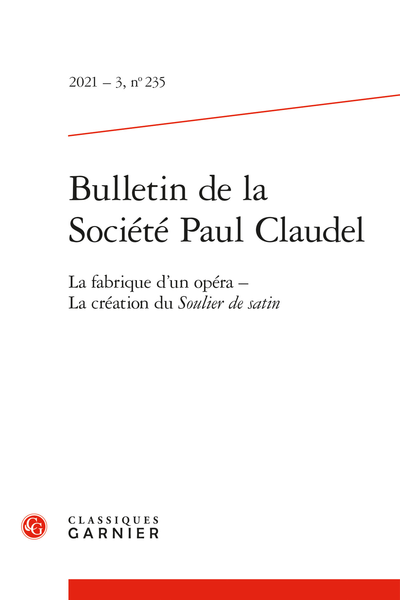
LA FABRIQUE D’UN OPÉRA – LA CRÉATION DU SOULIER DE SATIN /
THE MAKING OF AN OPERA – THE CREATION OF LE SOULIER DE SATIN
Sarah Barbedette
« Le pire n’est pas toujours sûr » /
“The worst is not always certain”, 13
Raphaèle Fleury
Journal de bord de la librettiste (fragments) /
Diary of the librettist (fragments), 17
Sarah Barbedette
« Une mélodie au-delà du souffle ». Entretien avec Marc-André Dalbavie /
“A melody beyond the breath”. Interview with Marc-André Dalbavie, 33
Sarah Barbedette
« Toutes les formes d’incandescence me fascinent ». Entretien avec Stanislas Nordey /
“All forms of incandescence fascinate me”. Interview with Stanislas Nordey, 51
Sarah Barbedette
Prouhèze, mezzo-soprano, par Ève-Maud Hubeaux /
Prouhèze, mezzo-soprano, by Ève-Maud Hubeaux, 63
Pascal Lécroart
Du livret à la dramaturgie opératique /
From the Libretto to the operatic dramaturgy, 71
ENTRETIEN / INTERVIEW
Christèle Barbier
« Un possible impossible » – l’expérience du Soulier de satin au théâtre à la table de la Comédie-Française. Entretien avec Éric Ruf /
“An impossible possibility”—The experience of Le Soulier de Satin in the theatre at the table of the Comédie-Française. Interview with Éric Ruf, 85
NOTE / NOTE
Shinobu Chujo
Un supplément à la dramaturgie de Paul Claudel /
A supplement to the dramaturgy of Paul Claudel, 101
EN MARGE DES LIVRES / BOOK REVIEWS
Didier Alexandre (dir.), Paul Claudel, aujourd’hui (Amélie Auzoux), 117
Pascal Lécroart et Dominique Millet-Gérard (dir.), « L’avènement d’un art nouveau». Essaimage esthétique et spirituel de l’œuvre de Paul Claudel (Catherine Mayaux), 121
ACTUALITÉS
Catherine Mayaux et Marie-Victoire Nantet
Rencontres de Brangues, 129
Michel Wasserman
Hommage. Moriaki Watanabe, 133
Résumés/Abstracts, 135
« UNE MÉLODIE AU-DELÀ DU SOUFFLE »
Entretien avec Marc-André Dalbavie
Sarah Barbedette : En juillet 1987, le centre Acanthes – académie de musique contemporaine consacrée cette année-là à Olivier Messiaen – est accueilli pour la première fois à Villeneuve-lès-Avignon. Ce même été, Pierre Boulez attire ton regard vers la programmation du Festival d’Avignon où Antoine Vitez monte Le Soulier de satin…
Marc-André Dalbavie : Oui. C’est Boulez qui m’a fait connaître Claudel. À l’époque, je lisais des romans et n’avais pas cette dextérité que demande la lecture d’un texte théâtral. La littérature qui me passionnait, c’était le Nouveau Roman, la littérature américaine – Faulkner notamment… En 1987 je ne connaissais Claudel que de nom même si, bien sûr, j’avais déjà écouté Jeanne au bûcher. Quand Pierre m’a dit, trois jours avant, « Il faut que tu ailles écouter ça, c’est magnifique », je n’ai pas eu le loisir de me préparer et j’y suis allé sans même avoir eu le temps d’acheter le livre. Par la suite, j’ai lu Partage de midi, L’Annonce faite à Marie mais je me suis encore heurté à ce manque de familiarité avec l’écriture théâtrale. Il y a cinq ans lorsque j’ai commencé à travailler sur Le Soulier de satin, j’ai recommencé à lire beaucoup de textes de Claudel.
S. B. : « Pour superposer un texte musical au texte de Claudel, il faudrait opérer un grand nombre de coupures. Le texte en sortirait passable- ment défiguré et amaigri » écrivait Pierre Boulez avant de conclure à l’impossibilité de mettre en musique Le Soulier de satin1. Quels étaient ton sentiment face à l’œuvre, et ton idée du livret ?
M.-A. D. : Quand j’ai commencé à discuter avec Stéphane Lissner, il avait cette idée de grands textes de la littérature française, mais nous avons discuté d’abord de Tchekhov, d’auteurs russes, et sommes arrivés progressivement à Claudel. Dès que le nom de Claudel a été lancé, Le Soulier de satin s’est imposé. Et je dois avouer que cela a d’abord entraîné chez moi une réticence, parce que je connaissais l’œuvre. Je connaissais l’écriture de Claudel et je ne voyais pas comment on pouvait mettre en opéra une œuvre qui est déjà difficile pour le théâtre. Pour moi, Le Soulier de satin de Claudel est presque un opéra. Cela tient à certains personnages, qui sont des stéréotypes de l’opéra, au travail sur la langue extrêmement varié, riche, à la forme du vers claudélien. Il y a aussi la longueur de l’œuvre : celle-ci installe une temporalité qui n’est pas sans rapport avec le fait de s’enfoncer dans un temps autre – c’est le cas des opéras de Wagner ou, au xxe siècle, d’Einstein on the Beach de Philip Glass. Le temps musical nous déconnecte, on passe ailleurs. Toutes ces caractéristiques font à mon sens que Le Soulier est déjà un opéra. Ma première réaction a donc été la perplexité. Je ne savais pas si cette folie était possible : il y a des folies créatrices, d’autres qui ne le sont pas. J’ai demandé à réfléchir et, le lendemain, j’ai rappelé Stéphane Lissner en lui disant que c’était bon.

Fig. 1 – Don Rodrigue (Luca Pisaroni), IIIe journée, sc. 10.
Crédit : © Élisa Haberer / Opéra national de Paris.
Pour ce qui est du livret, je ne savais pas ce que je voulais, mais je savais ce que je ne voulais pas. Le premier librettiste, Christian Longchamp, a fait deux versions : une première seul, et une deuxième avec Alvis Hermanis qui a opéré d’autres types de coupes et de fusions de personnages. Ces propositions consistaient en un opéra de format classique de 2h30 ou 3h, reposant uniquement sur l’histoire de Rodrigue et Prouhèze. Or c’est à partir de cet amour très particulier imposé par Prouhèze à Rodrigue, un amour qui ne peut se réaliser sur terre, qu’ils sont projetés à travers le monde. C’est cet amour impossible qui fait que Rodrigue part, et que Prouhèze part. Dans un livret où n’est cerné que l’amour entre les deux personnages et leur relation, l’effet de projection disparaît. Alors même que cet amour est au cœur de l’exploration du monde, donc de la recherche du prochain, des autres cultures. Toute cette hétérogénéité avait été enlevée pour faire un objet parfaitement homogène. Il est très difficile à l’opéra d’atteindre au chaos, mais si l’on appuie sur l’accélérateur homogénéisant de l’opéra, on détruit tout le reste. Le sens et l’esthétique s’étaient trouvés du même coup annulés.
S. B. : La musique innerve le texte, avec des statuts très différents, qui vont de la didascalie au discours, de l’image poétique au souffle de l’acteur. Que cette langue soit éminemment musicale en fait-il le moteur essentiel de l’écriture ?
M.-A. D. : La présence de la musique est très frappante dans Le Soulier de Satin, avec des personnages comme Doña Musique, la mention de l’orchestre – au début, dans la IIIe Journée, à la fin –, les effets de mise en abyme créés par tous les appels à la musique, la mention des instruments, de la guitare, des chants d’oiseaux… Pour autant, ce qui m’a attiré en premier lieu, c’est la force du vers claudélien, la musicalité de la langue. Je sais que Claudel a conçu L’Annonce faite à Marie comme un « opéra de paroles», mais en ce qui concerne Le Soulier, je pense qu’il est parfois plus près du chant que de la parole. Certes, dans certains dialogues assez courts, performatifs, on est dans la parole, mais souvent encore à la limite de la musique. Dans le vers, toutes les inversions qui obscurcissent le sens rendent, par effet de disparition, l’oreille plus attentive au son. Nombreuses sont les phrases où le son s’équilibre avec le sens par le fait que la syntaxe est perturbée. Et cela produit parfois un effet de décalage : le sens n’est perçu qu’après coup, lorsqu’une autre phrase amplifie le sens que la première avait proposé dans une syntaxe telle que la perception du signifié restait en quelque sorte à l’état translucide… Finalement c’est le vers suivant, ou la réponse de l’autre personnage qui éclaire le propos. En cela, Claudel frôle la musique, le chant. Cette musique qu’il y a dans la phrase est même très lyrique. Il y a un souffle très singulier, que l’on ne retrouve pas chez les auteurs de théâtre contemporains de Claudel. Dans une poésie où il y a du souffle, il y a de la respiration, et très vite on bascule dans du chant. Cela m’avait d’autant plus frappé que mon premier contact a été un contact de pure parole, sans l’entremise de l’écrit : j’ai vu et entendu Le Soulier de satin avant de le lire.
S. B. : « Que j’aime ce million de choses qui existent ensemble» (Rodrigue, I. 7). Le Soulier de satin porte sur la scène une pluralité de mondes. Cette pluralité fait partie intégrante de ta démarche de compositeur depuis de longues années – je pense par exemple au choix que tu as fait à plusieurs reprises de mettre en musique des textes d’Ezra Pound…
M.-A. D. : Oui. Mon intérêt ne se limite pas à l’œuvre d’Ezra Pound, mais clairement, il se porte sur les écritures autres : musique pygmée, musique chinoise, musique de Bali, musiques hindoues… Dès les années 1980, je m’intéresse aux musiques non européennes – ce qui présuppose déjà plusieurs mondes. J’ai écrit plusieurs œuvres mixtes avec instruments chinois et extra-européens ; d’autres de mes œuvres ont été influencées par l’hétérophonie des musiques pygmées. Chez Pound, m’intéressait l’idée de « traduction interprétative », de « transfert ». Il avait une vision de la traduction très personnelle, qui incluait l’hétérogénéité. C’est cela qui m’attirait. J’ai aussi écrit Chants [en 2003], sur les Cantos, poésies de troubadours. De même, j’ai toujours été intéressé par les compositeurs qui abordent la notion d’hétérogène comme Beethoven, ou comme Mahler. Sous cet angle, on peut dire que j’étais prêt pour Claudel !
S. B. : Le Soulier de satin fait suite à Charlotte Salomon (2014), Gesualdo (2010) et Correspondances (1997). On peut tirer des fils d’Ariane – la musique comme sujet notamment – entre ces opéras et Le Soulier de satin dont tu commences l’écriture immédiatement après les représentations de Charlotte Salomon.
M.-A. D. : Peut-être peut-on en dessiner a posteriori ! Gesualdo est un opéra sur un compositeur qui écrit de la musique. L’époque est la même que dans Le Soulier de satin – mais l’opéra se déroule en Italie. Je peux dire aussi que le librettiste, Richard Millet, est un claudélien, écrivain catholique, très intéressé par la musique. Sur Charlotte Salomon, on peut aussi trouver des correspondances, et la première est à mon sens l’hétérogénéité. Charlotte Salomon peignait sa vie comme une bande dessinée, mais en intégrant à ses peintures de la musique et des textes. Elle chantait quand elle peignait, et cette musique était la source de sa créativité. Il y a aussi le temps qui, dans tout le début de son œuvre, est bouleversé; il se linéarise ensuite de plus en plus, jusqu’à ce qu’à la fin, elle ne parle que de ce qu’elle ressent au présent. Ces types d’hétérogénéité entre la musique et la peinture d’une part, et l’absence de linéarité d’autre part, font penser au Soulier : le temps n’y est pas non plus linéaire, il est découpé, il y a des ellipses… et dans ces deux cas la polyphonie des histoires qui se chevauchent produit un effet hétérogène, fût-il de nature différente : Claudel et Charlotte Salomon n’explorent pas les mêmes ressorts. Pour Charlotte Salomon, j’ai commencé à travailler avec Richard Millet, qui n’a pas utilisé l’œuvre picturale de Charlotte, son autobiographie Leben? oder Theater? Ein Singspiel, comme socle de l’écriture. Or en travaillant avec Luc Bondy, nous avons acquis rapidement la certitude qu’il ne fallait pas raconter la vie de Charlotte, mais exposer son œuvre : que la vie de Charlotte Salomon soit racontée avec ses propres mots. Donc nous avons demandé à Barbara Honigmann, qui est allemande, d’écrire le livret, et l’opéra est finalement bilingue. Charlotte Salomon était berlinoise, n’a découvert ses origines juives qu’en 1933, et a réalisé son œuvre en allemand et en français. Là aussi, plusieurs cultures se croisent. Contrairement à Gesualdo, mais comme pour Le Soulier, le livret se fonde sur un texte préexistant.
S. B. : Ces quatre opéras jalonnent un catalogue d’œuvres marqué par la voix – que ta découverte de la musique spectrale au Conservatoire de Paris en 1981 n’a pas éloignée, mais plutôt impérieusement rappelée. Peut-on dessiner les grandes lignes de ta démarche de compositeur en regard de ces œuvres lyriques ?
M.-A. D. : Oui. L’histoire du chant est très importante pour moi. Quand j’étais jeune, j’étais très intéressé par tous les courants de la musique spectrale – par d’autres aussi évidemment. C’est une esthétique qui explore surtout l’harmonie, et qui évacue la mélodie. Dans la musique spectrale, la mélodie est emprisonnée dans l’harmonie, neutralisée par l’harmonie. Il n’y a que des enchaînements d’accords. Pendant un an ou deux, j’ai beaucoup aimé cela. Parce que le fait d’évacuer la mélodie permettait d’ouvrir de nouveaux horizons harmoniques. Mais très vite, passé ce premier mouvement d’exploration, la mélodie m’a manqué. Elle a toujours été fondamentale pour moi; adolescent, j’étais fasciné par le chant grégorien, et cette attirance pour la musique spectrale a nécessairement représenté une cassure. D’un coup je suis devenu orphelin de ce que j’adorais. J’ai donc voulu réinvestir l’aspect mélodique, tout d’abord avec une pièce pour alto et ensemble, Diadèmes [1986]. Puis je me suis dit que finalement ce qui me permettrait le plus de faire évoluer ce monde spectral dans lequel j’étais, ou de le distordre, c’était d’arriver au chant – où la mélodie est sublimée. La structure profonde de la mélodie vient du chant. Donc j’ai voulu réinvestir le chant, et j’ai commencé avec une pièce intitulée Seuils [1991-1993], à élaborer des bribes mélodiques – mélodico-spectrales. À partir de ce moment-là, j’ai multiplié les pièces vocales, et très vite le chant a été la plus grande source d’inspiration.
La deuxième ligne que l’on peut tracer dans mon écriture, et qui explique peut-être l’idée d’hétérogénéité, c’est que très vite, dès la pièce Diadèmes, je commence à superposer plusieurs processus. Dans la musique spectrale, il y a un élément très important qui ne vient pas des spectraux, mais de Ligeti voire de Bartók ou des minimalistes américains comme Steve Reich, qui est l’idée de musique à processus : une musique répétitive qui se transforme. C’est une musique non discursive, influencée par les musiques de Bali ou d’Afrique, par exemple, dans laquelle il n’y a pas de phrase suivant un dessin anacrouse-accent-désinence. Ce fond de répétition-transformation multiple est aujourd’hui encore très important dans mon travail. Depuis que j’ai commencé à superposer des processus, cette technique de composition par mixage – comme si j’utilisais une table de mixage avec deux ou trois pistes – me permet d’élaborer des relations multiples entre les différentes pistes : elles peuvent se contaminer, se bousculer, l’une devenant l’accompagnement, l’autre la mélodie… La superposition des processus se combine également avec des superpositions d’instrumentariums lointains, comme dans Double Jeu ou dans Mobiles2. C’est ensuite que j’ai abordé l’opéra. Tout cela s’est fait au fur et à mesure, et l’hétérogénéité s’avère être une constante. Je voulais réintroduire de la polyphonie dans cet univers répétitivo-spectral car je voulais redonner un aspect complexe et discursif à ma musique. Ceci étant, je voulais que l’aspect discursif ne soit pas l’intention première, mais le résultat de la polyphonie : c’est la collision qui produit du dis- cursif. Au regard de cette quête-ci, au sein de mon écriture, Le Soulier de satin est une sorte de climax – comme on le dirait d’un arbre qui arrive au sommet de son développement avant de se stabiliser, puis de décliner. Parallèlement à la quête mélodique – dans un monde harmonique qui l’a évacuée –, parallèlement aussi à la recherche polyphonique dont je viens de parler, j’ai développé la métatonalité, qui me vient de mon professeur Claude Ballif. Il s’agit là de réinvestir la notion de consonance, qui avait disparu de toutes les musiques savantes. Dans la perspective historique de la musique sérielle et postsérielle on s’est interdit la tonalité, la consonance, certains intervalles – à l’instar de Webern, Boulez ou Stockhausen… D’une certaine façon, la musique spectrale lève l’interdit de la consonance, et la réintroduit sous la forme d’harmonicité (l’harmonicité existe quand un spectre harmonique présente des partiels en rapport géométrique avec la fondamentale : c’est le cas de sons très purs produits par le vibraphone ou la flûte par exemple). On trouve à travers cette caractéristique harmonique une consonance post-atonale. Ce n’est donc pas un retour à la tonalité, un retour en arrière sur le plan de l’écriture : l’harmonicité tient compte des évolutions qu’a connues l’écriture de la musique. Lorsque Ballif établit la métatonalité, il pense un système qui englobe à la fois l’atonalisme et la tonalité, et qui créée des relations continues de l’un à l’autre.
Je suis donc en grande partie animé par la levée des interdits modernes, l’abandon de la tabula rasa qui était prônée par beaucoup de mes pairs. Tout le monde n’a pas la même définition de la musique spectrale mais, de mon point de vue, elle a pour caractéristique d’ouvrir le monde musical à tous les aspects du monde sonore. Elle veut réinvestir tous les aspects du bruit qui étaient écartés dans les musiques anciennes, classiques, où l’on essaye d’avoir un son très pur, mais aussi ceux de l’harmonie et de l’harmonicité. À partir du moment où l’on ouvre le champ musical à tous les aspects du monde sonore, on n’enlève pas un interdit, on enlève les interdits. C’est pour moi le grand message de la musique spectrale, et je suis l’un des seuls à le penser de cette façon car la plupart pensent que cette levée des interdits est limitée à l’harmonie.
S. B. : La définition que tu donnes de la musique spectrale est donc singulière, et cette ouverture maximale des possibilités d’écriture est un trait caractéristique de ta position au sein d’une génération de compositeurs…
M.-A. D. : Quand je commence à étudier la composition, je fais partie d’une génération où le compositeur est très engagé – dans une démarche politique, philosophique, idéologique… Ce que je ne suis pas du tout. Je m’intéresse certes aux mêmes choses que mes amis, mais pas pour les mêmes raisons. À côté du regard militant, politique qui est le leur, je me concentre sur les nouveaux horizons que m’ouvrent les œuvres, les techniques… Ce qui m’intéresse c’est de découvrir et d’explorer les choses, pas de transmettre un message. Je suis donc très différent du milieu dans lequel j’ai émergé – le fait de n’avoir aucune volonté de transmettre une quelconque idéologie étant même presque transgressif. Je n’entre donc pas du tout dans une généalogie contestataire de la modernité, et je me définis d’évidence plutôt du côté d’une généalogie exploratrice. Ceci étant, il est évident que déconstruire le passé a été la condition pour pouvoir accéder à d’autres horizons que ce qui était proposé à une époque. Il a été indispensable de contester ce qu’on avait appris pour pouvoir explorer d’autres modèles. Mais je suis arrivé pour ma part à une époque où il n’y avait plus de blocages, à un moment où, tout étant déjà cassé, je n’avais pas besoin de rejeter la culture qui m’avait produit pour accéder à une autre. La transgression m’intéresse, mais la contestation non. Donc j’étais en décalage par rapport à mes amis et par rapport à beaucoup d’artistes de mon âge.
S. B. : Revenons à l’écriture du Soulier de satin : la longueur de la pièce constitue pour le compositeur une tentation, mais elle n’est pas sans induire de nombreuses contraintes ?
M.-A. D. : Ce qui m’intéressait avec Le Soulier, c’était d’installer la durée : installer une temporalité qui fasse appel à la biologie du corps, avec des moments d’attention, et des moments d’inattention – accepter l’inattention. L’idée était même d’aller très loin dans le projet de Claudel : que les gens puissent se lever, partir, aller manger, revenir… Être comme dans un raga indien. Pour moi la durée était très intéressante. Je voulais rompre avec le rythme habituel de l’auditeur face à un drame qui se joue – finalement nous n’avons pas pu aller aussi loin.
Inévitablement, dans les phrases préparatoires, les problèmes pratiques se sont immédiatement imposés. Je savais que je pouvais organiser cette durée pour qu’elle soit tenable en ce qui concerne le chant. C’était possible, même si Rodrigue était très sollicité : comme il y a beaucoup de personnages, beaucoup de duos, la performance vocale était tenable, pourvu que je fasse attention à ne pas pousser les voix dans les extrêmes. Par contre pour les musiciens d’orchestre, non. Pour les « souffleurs » (l’harmonie et la petite harmonie), la durée demande une force physique exceptionnelle… Et même pour les violons et les altos – à la différence des violoncelles et des contrebasses – la position est fatigante. Pour les bois, les cuivres, les violons et les altos, la durée peut être difficile à gérer. Je savais que je ne pourrais pas avoir un orchestre qui joue du début à la fin. Il était donc inévitable, pour le ménager, que je divise l’orchestre à un moment ou à un autre, en groupes de musique de chambre, et que je compose des parties de percussions, de gamelan dont les instrumentistes pouvaient ne pas appartenir à l’orchestre. Cette idée de fractionner l’orchestre fonctionnait très bien dans la version longue conçue pour l’Opéra Bastille. Elle avait l’avantage de servir une conception spatiale mouvante, et résolvait les questions pratiques d’endurance pour les musiciens.
S. B. : Les personnages de l’opéra sont nombreux. Dès que tu as vu la pièce, leur valeur de stéréotype opératique t’a frappé, mais tu t’es aussi passionné pour l’hétérogénéité des caractères. Comment les dépeins-tu ?
M.-A. D. : La multiplicité d’univers auxquels appartiennent les personnages est une chose fascinante qui a évidemment eu son importance dans l’écriture.
Musique, Prouhèze et Rodrigue, Camille appartiennent selon moi à trois genres littéraires différents, mais pourtant entrent en interaction les uns avec les autres. Doña Musique est un personnage de conte. Le rêve prend corps quand elle rencontre le Vice-Roi de Naples – qui, lui, exprime toutes sortes de problématiques politiques réalistes –, ils se marient et ont un enfant, Jean d’Autriche… Tout cela relève d’un imaginaire de conte. Prouhèze et Rodrigue, eux, sont tout autant des personnages de théâtre racinien que, surtout, des personnages d’opéra. Ils vont jusqu’au bout, et même au-delà de toute extrémité. Il y a un aspect transcendant dans leur caractère, quelque chose qui excède le réel. Bien qu’étant un personnage de théâtre, Camille n’atteint pas ces extrêmes. Plus qu’un personnage d’opéra je dirais que c’est presque un personnage de cinéma. Sa psychologie est beaucoup plus réaliste que celles de Prouhèze et de Rodrigue. Il n’est pas du tout dans le même registre tragico-lyrique, mais n’en est pas moins un maillon fondamental pour permettre toutes les secousses que produisent les relations entre les personnes. Dans le billard il est la boule que l’on envoie pour créer des ricochets : c’est par lui que les personnages n’arrivent pas à se rencontrer, et se dispersent à droite et à gauche. Il produit la projection spatiale et, au contraire de Prouhèze et Rodrigue qui n’arrivent jamais à obtenir ce qu’ils veulent, lui maîtrise son destin et obtient ce qu’il veut. Par cette dimension humaine, il est un personnage particulièrement intéressant.
En Sept-Épées, je vois Brünnhilde. C’est un personnage d’opéra, et en même temps un personnage moderne, très émancipé. Je crois que c’est le seul pour qui je puisse citer un personnage-modèle clairement déterminé. Les autres sont plutôt la concaténation de plusieurs : dans Prouhèze, il y a Salomé, Électra… De même pour Rodrigue les références sont multiples. Alors que Sept-Épées est un personnage simple, très lisible, dont la grandeur, la force, la vivacité, la sincérité font la beauté… C’est un personnage que j’aime énormément – et c’est à mon regret le personnage le moins développé dans la forme actuelle de l’opéra… L’Ange est un personnage encore autre, qui a une dimension religieuse.
Cet Ange Gardien est un personnage de la tradition à la fois populaire et religieuse. Il est là et il n’est pas là. Comme Claudel a une vision radicalement incarnée de la divinité, tout ce qui est transcendant ne peut exister qu’en un corps. Or l’Ange a non seulement un corps mais une psychologie. Lors de la première rencontre avec Prouhèze, au moment où elle s’échappe, il est son double. C’est très beau : on ne sait qui, de l’Ange ou de Prouhèze, s’exprime. Mais au fur et à mesure, ce double se défait : d’ange gardien il devient un ange précepteur. Il finit par dialoguer avec elle, et lorsqu’ils se retrouvent la deuxième fois, ils sont quasiment dans un dialogue réel, comme si l’Ange Gardien était sur terre. Cette modification, on la retrouve dans les lignes de chant de Prouhèze et de l’Ange : elles sont au départ très proches, en imitation, en canon puis, au fur et à mesure, se disjoignent. De même pour Doña Musique : au départ c’est une petite jeune femme pleine de vie qui veut tomber amoureuse, elle a un chant extrêmement ornementé. Elle devient à sa deuxième apparition plus sérieuse, le chant reste ornemental, mais il s’apaise. Et quand elle trouve la personne dont elle veut être amoureuse, elle gagne en sérieux. Puis vient la prière de Musique : la guerre l’entoure, elle prend conscience de graves enjeux. Son discours de femme adulte consciente du rôle qu’elle joue s’inscrit dans une ligne vocale qui s’apparente au chant grégorien, avec des ornements plus proches des tropes que du bel canto. L’ornement est toujours là, mais il change, devient beaucoup moins festif. Avec l’Ange c’est pareil, il y a une évolution dans la technique de chant à mesure que son personnage s’écarte de Prouhèze. Et chez Prouhèze également, la musique exprime l’évolution de son personnage qui, de très classique, devient peu à peu Prouhèze.
Parmi les autres personnages, Balthazar est, à mon sens, un personnage d’opéra tel qu’on peut en trouver chez Verdi, avec Falstaff par exemple, ou même chez Mozart. C’est typiquement une figure de roman du xixe siècle, une sorte d’Athos : loyal, plein d’honneur et bon vivant, mais aussi fataliste. Un militaire, dont le code de l’honneur est plus fort que tout. À la fois noble et homme du peuple, il s’abstrait un peu de la hiérarchie sociale : il obéit à Don Pélage, a connu le père de Prouhèze, qui hiérarchiquement était plus important que lui. Son rôle est certes d’obéir aux ordres, mais aussi d’endosser les responsabilités. Ce n’est pas un simple exécutant. C’est un personnage passionnant, qui a une psychologie très fine.
Don Fernand, le Capitaine, le Sergent napolitain relèvent d’un théâtre vraiment classique, mais pas tragique : celui de Molière, de Beaumarchais. Ce sont ces personnages malins qui apparaissent dans des opéras comme Les Noces de Figaro. Quant à Doña Isabel, Don Ramire et tous les personnages de la fin, je les vois comme des personnages de roman. Il y a chez eux cette forme de réalisme que l’on offre au lecteur de roman, mais que l’on ne trouve pas au théâtre ni surtout à l’opéra, où les personnages gagnent en radicalité.
Viennent ensuite les personnages d’acteurs : je voulais du théâtre et de l’opéra. Toujours dans l’idée de confronter les genres, de les faire entrer en collision, je ne voulais pas que l’opéra soit purement opératique du début jusqu’à la fin. Le Chinois était donc typiquement un personnage intéressant. J’ai déterminé son personnage à partir de la scène avec Balthazar : il doit chanter mais il chante mal parce qu’il ne sait pas chanter. Son rôle a donc été conçu pour un acteur parce que je savais que je n’obtiendrais pas la même chose qu’avec un chanteur. Par la suite je me suis rendu compte que ce choix était bon car lors de la rencontre entre le Chinois et Rodrigue, l’effet comique est accentué par le fait que l’un est tout le temps en train de chanter tandis que l’autre parle. Le Chinois est hyper matérialiste, chez lui tout est matière à calcul. Cela en fait un personnage très drôle, et le contraste avec Rodrigue se trouve renforcé dans cette scène. Pour Jobarbara, j’ai beaucoup hésité entre la faire chanter et la faire parler. J’ai pris le parti d’une danseuse-actrice parce que son personnage a les pieds sur terre. Elle est à la fois sorcière, et très rationnelle. C’est quelqu’un qui n’est pas dupe, quelqu’un qui sait, qui est clairvoyante. Son rapport au réel est parfaitement assumé, c’est la raison pour laquelle je ne la voyais pas chanter. Pour moi, lorsque les personnages chantent, c’est qu’ils commencent à exprimer quelque chose que les paroles tendent à avoir de plus en plus de mal à exprimer, ou quand l’émotion commence à déborder la parole – ceci est étroitement lié avec ce que je ressens dans tous les opéras que j’ai faits, et dans le même temps en rapport étroit avec ce que dit Doña Musique : « Celui qui ne sait plus parler, qu’il chante ! » Enfin l’Irrépressible et l’Annoncier : ce sont pour moi deux personnages pirandelliens qui viennent déconstruire l’illusion théâtrale – même si chez Claudel elle n’est pas voulue comme déconstruction : c’est plutôt un jeu d’oscillation entre plusieurs mondes. Cela me fait penser aux dernières peintures de Cézanne sur la Montagne Sainte-Victoire, où il peint avec de petites touches carrées : de loin on voit une Sainte-Victoire comme à travers une vitre dépolie puis plus on se rapproche, plus on voit le geste du peintre, le coup de brosse. Et du vert de l’arbre on passe au vert de la peinture. L’image disparaît complètement dans le plan rapproché et c’est fabuleux. Ces deux personnages, l’Irrépressible et l’Annoncier, ont une double qualité, qui donne à voir l’idée de Claudel selon laquelle il doit y avoir un côté improvisé et où se lit l’influence du théâtre asiatique, surtout indonésien, mais aussi du kabuki… J’ai donc voulu garder le côté naturel de la voix parlée.
Avec la Lune, on est encore dans le conte : un conte pour enfant, un lullaby. Je la conçois plutôt comme une voix qui nous parle, comme une voix intérieure et qui dans le même temps nous donne un point de vue transcendant sur l’action. Ce personnage s’incarne dans une voix, mais n’apparaît pas forcément dans sa chair. Il nous parle comme s’il nous chuchotait à l’oreille.
Pour l’Ombre Double, j’ai hésité. Je pensais avoir une voix très déclamée, assez agressive, qui ne s’est pas trouvée dans le spectacle. Je n’avais pas pensé l’Ombre Double telle que Stanislas Nordey l’a produite, remplaçant la parole par l’écrit. Néanmoins, ce choix a la vertu d’augmenter la séparation des éléments, des genres. J’ai donc accepté cette idée d’une sorte de performance de poésie graphique. Je l’ai trouvé intéressante, même si je voyais cette scène comme un théâtre d’ombres, à l’indonésienne, et pensais créer un mélange électronique entre les voix de Prouhèze et de Rodrigue, une voix mixte. Ce personnage est le résultat de deux personnes réunies, on ne peut pas le résumer à l’une et l’autre assemblées, c’est encore autre chose. Aussi mon projet initial était-il de faire une chimère : une parole transformée par de l’électronique, qui pouvait rendre cette idée.
S. B. : La parole des personnages, justement, est portée par des modalités très précises.
M.-A. D. : Il y a plusieurs niveaux : le parlé courant, le parlé déclamé – qui est parfois rythmé dans la partition –, le parlé prosodique – pas le recto tono qu’on trouve dans le chant grégorien, mais plutôt une prosodie indiscernable du chant : la note est là sans être vraiment là, il s’agit de rendre une oscillation continue entre plusieurs types de production de parole, où l’on entre dans quelque chose de poétique, qui doit certainement à la déclamation racinienne telle que je l’avais entendue dans les spectacles de Villégier au début des années 1980 –, vient ensuite le Sprechgesang – un parlé qui est presque chanté, qui fait référence à Schoenberg, mais pour lequel je pense aussi à la chanson populaire et à des intonations comme celles que pouvait avoir Barbara –, le récitatif que l’on trouve dans les opéras classiques, le chanté, et le chanté lyrique. Selon ce que dit la phrase, l’alternance de ces modes d’écriture peut être très rapide. C’est un peu comme les voitures hybrides : dès qu’on accélère un peu, on change de moteur! On passe du moteur électrique au moteur à explosion parce qu’il est plus puissant. Selon ce que dit la phrase, ce qu’elle suppose et ce qu’elle provoque comme émotion dans la personne qui le dit, le chant émerge ou pas. Il émerge en plusieurs types d’intensité.
S. B. : Et ces intensités sont travaillées à une très petite échelle : en décortiquant la phrase, c’est à chaque mot que tu réagis. Or le vers claudélien est particulièrement riche…
M.-A. D. : Oui. Je voulais que ces passages d’un mode à l’autre paraissent « parfaitement naturels ». Cela fait longtemps que je travaille là-dessus. Mais avec Le Soulier de satin, on perd toute commune mesure avec ce que j’ai pu faire jusqu’ici. Car si l’on regarde bien l’écriture de Claudel, la construction des phrases va du cri à la phrase la plus lyrique et la plus alambiquée. La richesse qu’il a mise en place dans Le Soulier de Satin est impressionnante. J’ai inévitablement retiré beaucoup de phrases poétiques, beaucoup de commentaires, d’adjectifs (qui prennent trop de place, sauf quand ils ont un rôle performatif) qui pour l’opéra posent problème, mais la richesse syntaxique est bien présente. La critique que l’on peut faire du texte de Claudel au point de vue de l’opéra, c’est que les digressions, les commentaires philosophiques y sont excessivement nombreux… Beaucoup trop de propos sortent de l’action, ralentissent la tension entre les personnages, se surajoutent à ce que l’on a déjà compris. Il faut bien comprendre que le sens d’une phrase longue, quand elle est chantée, a de grandes chances d’échapper au public si le début est trop éloigné de la fin. La caractéristique d’une phrase qui convient à la mélodie chantée, c’est sa brièveté, et sa simplicité : une phrase qui va directement au fait. Nonobstant, ce qui m’intéressait dans le vers claudélien, c’était de pouvoir explorer une mélodie qui n’arrive pas à finir, un chant qui rebondit en permanence. J’ai donc conservé cette mélodie plus longue qu’une mélo- die. Et à chaque fois que ce vers claudélien long, avec des inversions et une écriture très riche apparaît, la ligne mélodique qui le porte est une ligne mélodique qui n’arrive pas à se clore et à se conformer au schéma anacrouse-accent-désinence. Je voulais parvenir à faire une mélodie qui constamment rebondit par ricochet et devient presque infinie. Faire pas- ser ce vers claudélien dans le chant est la raison principale de cet opéra. C’est un vrai défi. Cela va à l’encontre de tout ce que l’on fait en chant habituellement. Et cela je ne l’ai jamais fait avant. Jamais je n’ai eu de texte avec des phrases infinies comme cela. Cela a d’ailleurs été très dur, il faut le dire. Il y a des moments où je n’y arrivais pas tellement c’était difficile. Il fallait constamment que le chant paraisse naturel alors que dans le même temps il va au bout du souffle.
J’ai aussi travaillé sur des tensions qui accroissent cette problématique : par exemple Prouhèze est un rôle chanté par une mezzo, et j’avais même spécifié une mezzo qui tende vers le contralto, or je l’utilise beaucoup comme une soprane. Parce que je voulais cette tension. Ceci étant, je n’ai pas écrit pour soprane, j’ai bien écrit pour une mezzo qui tend vers le contralto et beaucoup ont découvert la beauté de la voix d’Ève-Maud [Hubeaux] dans le grave. Il est clair que le cœur de mon intérêt était là, il était purement vocal.
S. B. : Comment caractérises-tu les personnages musicalement ?
M.-A. D. : Dans Le Soulier et dans toute ma musique, il y a plusieurs processus musicaux répétitifs qui se transforment et qui émergent de façon plus ou moins périodique. Progressivement se bâtit une musique au processus inéluctable de métamorphose. Ainsi il n’y a pas de figure ni de motif associés à un personnage, mais ce sont le caractère des intervalles ou le style qui se retrouvent : l’aspect ornemental de Musique, le côté extrêmement disjoint de Prouhèze. Il y a certes la quinte qui revient chez Doña Prouhèze et dont hérite Sept Épées. La fille de Prouhèze est constamment sur des cycles de quintes qui se chevauchent, du fait de ce que j’appelle son caractère de Walkyrie. Les personnages se retrouvent donc plus par des traits de caractère, des manières de traiter les choses que dans des motifs ou des mélodies. Balthazar par exemple parle beaucoup, et même quand il chante, il parle. Il est beaucoup moins lyrique que Rodrigue.
Quand j’écris, je dis le texte tout haut, et j’écris les notes que j’ai dites en parlant. Cela constitue mon point de départ. À partir de cela, la ligne vocale prend sa dimension en fonction de l’intensité émotionnelle de ce que le personnage dit ou ressent – ou de ce qu’il pense que l’autre ressent. Je ne fonctionne pas du tout sur des mélodies, sauf quand il y a des arias (par exemple l’air à boire de Balthazar ou l’air de Doña Isabel à la fin). Il y a des airs parce que j’ai voulu, du point de vue du style, jouer le jeu de l’opéra. Je n’ai pas voulu faire du théâtre musical, même s’il y a des moments de théâtre musical. J’ai voulu réinvestir l’opéra et m’inscrire dans l’histoire d’un genre. Je n’ai pas voulu écarter l’opéra ou faire une nouvelle forme comme l’ont fait Kagel, Aperghis ou Berio. Bien sûr, l’opéra est relu à travers des moments de théâtre, et il n’y a pas que de l’opéra, mais les lignes vocales que j’écris peuvent aboutir à un aria et c’est très important. Je pense qu’à l’opéra il doit y avoir des moments d’aria – c’est d’ailleurs l’absence de véritable aria que je reproche un peu à Pélleas et Mélisande. J’ai donc écrit la chanson de Balthazar, où il énumère toutes les bonnes choses à manger, les petites chansons du chinois, et puis les grands duos, les quatuors… je n’ai pas voulu écarter ces dimensions traditionnelles de l’opéra.
Le quatuor de Camille, Prouhèze, Rodrigue et le Capitaine (II, 6) est même, tout en appartenant à cette forme traditionnelle de l’opéra, un climax de ma propre esthétique. Pour ce quatuor, le livret a rendu simultanés les deux duos qui, dans la pièce, sont joués l’un après l’autre. Cela tient au fait que sur le plan temporel, l’action des deux duos se déroule au même moment, et qu’au plan spatial, ils sont en vue l’un de l’autre, s’observent l’un sur le bateau et l’autre dans la forteresse de Mogador. Le fait de les regrouper produit un effet polyphonique parfaitement musical tout en étayant la dramaturgie : ces deux duos ne se rencontrent pas, mais des croisements se découvrent peu à peu : ce que dit Prouhèze à Camille, elle le dit aussi à Rodrigue, qui lui-même tient d’autres propos que les mots adressés au Capitaine… Et ce dialogue par coïncidences révèle, jusque dans les mots, l’écriture par coïncidences de processus que j’élabore dans la partition.
S. B. : Tu viens de dire que la parole est au fondement de l’écriture du chant…
M.-A. D. : Oui : le chant n’est qu’une extension de la parole du point de vue de son mélisme. Je pars toujours d’une déclamation du texte que je fais moi-même : je lis le texte, je le déclame comme si j’étais au théâtre, et je note les rythmes et les notes que je dis, qui sont des notes parlées. À partir de là, je produis le chant. L’orchestre, lui, explore les voyelles en quelque sorte : à certains moments il est complètement guidé par la voix, et ses résonances sont produites par le chant. Comme l’orchestre est un système polyphonique, il est pour partie une extension de la vocalité, et pour partie un ensemble de processus qui viennent des éléments de théâtre comme les cloches du bateau par exemple qui produisent des harmonies… Tout ce qui est sonore dans la pièce de théâtre de Claudel devient de la musique. Ainsi le jeu avec les instruments extra-européens.
S. B. : Ces instruments extra-européens sont moins présents qu’initialement prévu. Comment le rôle et la nature de ceux-ci ont-ils évolué au fil des modifications successives du projet ?
M.-A. D. : Dans le projet de départ, j’avais prévu un groupe de musiques arabes, un groupe de musiques sud-américaines, un groupe de musiques chinoises, etc. J’avais travaillé avec un musicien iranien, Mohammad Torabi, sur les instruments que l’on utilise de l’Iran jusqu’au bout du Maghreb, en Algérie. De tous ces instruments-là, je n’ai gardé que le santur, qui est de la même famille que le cymbalum. Le cymbalum est un instrument hongrois, mais appartient à une famille d’instruments présente dans tout le bassin méditerranéen – et dont certains éléments se trouvent jusqu’en Chine. Ils sont plus ou moins grands, joués avec baguettes ou pas… Lorsqu’il y a eu ce bouleversement de la mise en scène et du lieu de représentation, j’ai dû faire des choix substantiels. Les groupes d’instruments ont disparu et je n’ai conservé que certains instruments. Le groupe de musique arabe est devenu le cymbalum, seul à subsister. Le temps manquant pour que je puisse travailler avec un musicien ne sachant pas nécessairement lire la musique – ce qui aurait été le cas pour le santur –, et dans la mesure où je n’ai pas pu faire venir un musicien d’orchestre égyptien, j’ai opté pour le cymbalum. J’ai également gardé le steel drum, mais là aussi il a fallu trouver un musicien capable d’en jouer dans un orchestre d’opéra – et nous avons trouvé. Quant aux bols chinois, gongs et bonan warung… je les ai gardés, car les percussionnistes de l’orchestre savent les jouer. Le célesta quant à lui apparaît à deux moments très importants avec l’Ange. Il est employé de façon extrêmement précise ; il est aussi présent à des moments où le personnage est ailleurs par la pensée. Enfin pour le petit orchestre baroque présent sur scène, les musiciens avaient leur archet baroque quand ils ont joué (archet avec des crins de chevaux dont la tension et la tenue sont différentes). J’ai aussi conservé la guitare baroque (prêt du Musée de la musique), que l’on trouvait en Amérique latine. C’est lorsque Rodrigue est en face de Panama qu’on l’entend.
J’ai donc dû prendre des décisions assez radicales, mais n’en suis finalement pas mécontent : les instruments sont ainsi intégrés à la formation, et cela donne un orchestre beaucoup plus étendu en couleurs sonores que ne l’est l’orchestre symphonique. Le cymbalum intervient certes quand il est question d’Afrique, mais pas seulement : étant intégré à l’orchestre, il se déploie tout autrement sur l’ensemble de la partition.
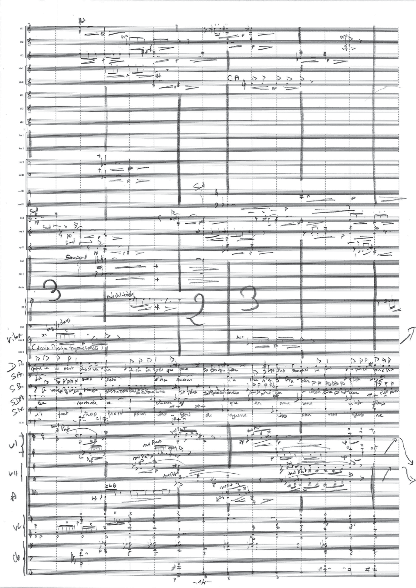
Fig. 2 – Marc-André Dalbavie, Le Soulier de satin, partition manuscrite autographe de la J.III, sc. 2, p. 14 : Doña Musique : « Quand on ne peut plus se servir de la parole que pour se disputer, alors pourquoi ne pas s’apercevoir qu’à tra[vers le chaos il y a une mer invisible ?] ». Crédit : © Lacroch éditions – M.-A. Dalbavie.
S. B. : Comment as-tu considéré les didascalies dans lesquelles Claudel fait appel à la musique ?
M.-A. D. : Il faut bien voir qu’il y a une très grande différence entre Raphaèle [Fleury] et moi par rapport à Claudel : Raphaèle avait un rôle d’interprète, de médiateur respectueux de Claudel, tandis que pour moi il était avant tout question de faire mon opéra. Donc Claudel est pour moi un point de départ. D’une certaine manière, je pense avoir respecté Claudel, mais ce n’était pas ma volonté. Dans la plupart des cas, ce qu’il écrit sur la musique n’est tout simplement pas réaliste, pas possible ou infaisable dans un opéra. Quand il parle de la musique, c’est une espèce de rêve, dans lequel il y a de la naïveté. On pourrait comparer cela à quelqu’un qui regarde des étoiles et n’en parle pas en astrophysicien.
Au départ je ne voulais donc pas du tout tenir compte de ces didascalies. Et finalement je me suis résolu à employer certaines choses, mais très librement. Mon attitude a plutôt été de me dire : je sens ce qu’il veut, mais je ne veux pas faire ce qu’il veut. Ce qui m’intéresse en revanche, c’est si ce ressenti peut susciter quelque chose chez moi. Dans le cas où rien ne se produit, je ne tiens pas compte de la didascalie, et si quelque chose se déclenche qui m’intéresse, alors j’en tiens compte. Voilà comment j’ai fonctionné : rien de systématique ou de rationnel de ce point de vue-là, parce que mon idée était de faire un opéra. Pas de faire Le Soulier de satin de Claudel. J’écris une œuvre autre, même si son titre est Le Soulier de satin – et que je suis très reconnaissant aux ayants-droits d’avoir accepté cela. Finalement, c’est un peu comme l’Otello de Verdi et l’Othello de Shakespeare : la différence est grande de l’un à l’autre…
Propos recueillis les 18, 24 et 29 juin 2021
Bibliographie
Paul Claudel, Conoscenza dell’Est. Frammenti in prosa dall’Estremo Oriente (1895- 1905), Traduzione, note e saggio introduttivo a cura di Simonetta Valenti, Torino, L’Harmattan Italia, maggio 2021, 200 p.
Paul Claudel et Saint-John Perse, chemins croisés, sous la direction de Muriel Calvet, directrice de la Fondation Saint-John Perse, et Catherine Mayaux, Publication de la Fondation Saint-John Perse, Aix-en-Provence, 2021, 216 p. Cet ouvrage accompagne l’exposition sur le même sujet présentée à la Fondation Saint-John Perse (Cité du Livre, Aix-en-Provence) du 20 novembre 2021 au 19 mars 2022.
Claude-Pierre Pérez, Paul Claudel « Je suis le contradictoire », biographie, Les Éditions du Cerf, 2021, 568 p.
